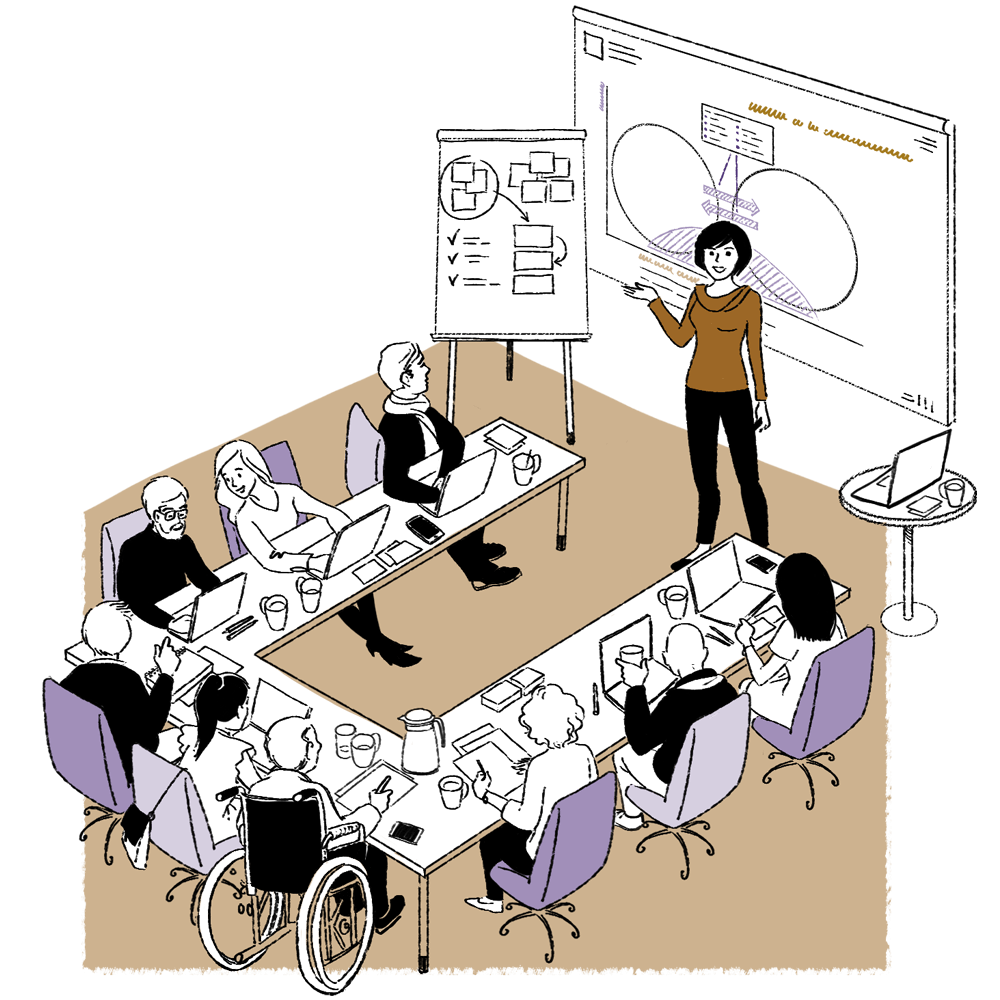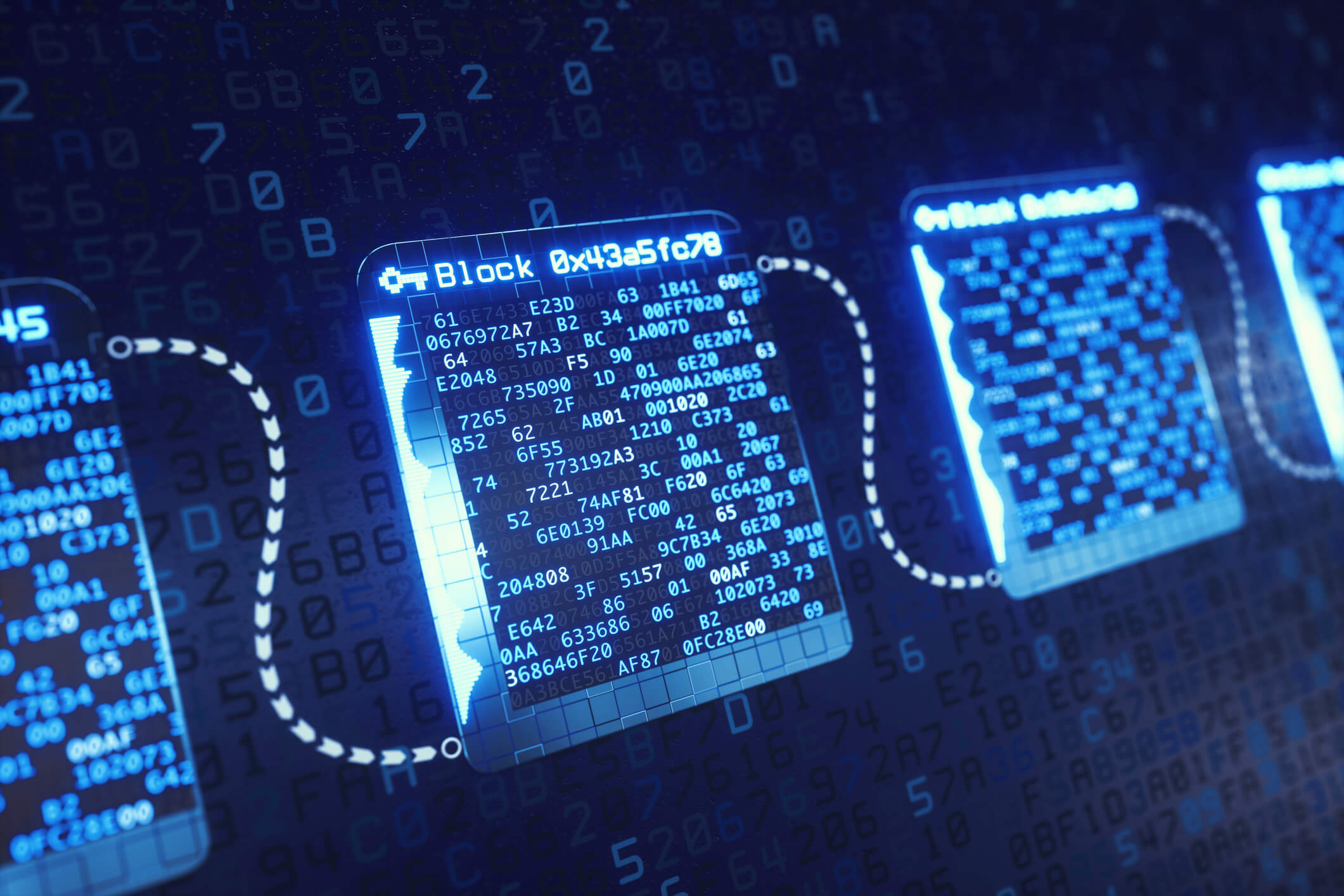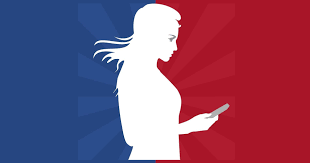Lorsque l'on réfléchit au mode de vie des travailleurs numériques, on imagine souvent des travailleurs qui n'ont que rarement, voire jamais, à se rendre dans un bureau. Dans cet imaginaire, l'internet permet aux gens de fixer leurs propres horaires, même s'ils sont parents et travaillent à domicile. En quittant un environnement d'entreprise de type Initech, les travailleurs sont censés jouir d'une plus grande liberté dans leur vie professionnelle et personnelle.1 Parfois, les gens supposent que des plaisirs et des privilèges particuliers découlent de la gestion d'une entreprise en ligne, de la diffusion en continu de jeux sur Twitch.tv ou du fait de travailler pour une entreprise comme Google. Il est facile d'ignorer que les obligations liées au travail numérique font qu'il est difficile de séparer la vie professionnelle de la vie privée, de fonder une famille ou de prendre un congé de maladie. Pendant plusieurs décennies, des chercheurs de toutes disciplines ont critiqué ces hypothèses sur la vie informatisée. Occasionnellement, ces travaux ont influencé les discours populaires sur la modération des comportements en ligne ou sur la promotion des entreprises émergentes de haute technologie pour stimuler le développement urbain. Dans ce chapitre, nous passons en revue une partie de cette littérature qui, pour de nombreux chercheurs, a eu tendance à provenir de régions d'Amérique du Nord et d'Europe et à s'y rapporter.
Nous nous concentrerons sur les croyances populaires qui façonnent les perspectives industrielles et universitaires du travail numérique, et nous examinerons trois types de sites de terrain qui guident souvent l'enquête critique sur les pratiques modernes de travail avec et par les technologies numériques : la culture d'entreprise dans la Silicon Valley, les plateformes de distribution de travail en ligne et les jeux virtuels. Dans chaque cas, les chercheurs ont remis en question les idées reçues sur le travail numérique dans leurs disciplines, en explorant la manière dont les ordinateurs façonnent les relations de travail contemporaines entre les personnes et les technologies à travers le monde. Imaginaires populaires de la Silicon Valley sur le travail numérique De nombreuses idées populaires sur le travail numérique tendent à provenir d'une focalisation persistante sur les "créatifs" - un sous-groupe spécifique de personnes impliquées dans le développement et la promotion des technologies informatiques. Il s'agit des personnes qui utilisent les technologies de l'information et de la communication (TIC) à un niveau technique et "créatif" - elles peuvent concevoir des logiciels, gérer des communautés en ligne ou raconter des histoires multimédias. Certains considèrent le travail créatif comme un idéal, qui détermine tous leurs choix éducatifs. Pour d'autres, il s'agit d'un choix de carrière alternatif que chacun peut adopter pour échapper au chômage ou au travail manuel.
Des titres tels que 220 Iris Bull et Ilana Gershon "Un homme de Floride dit qu'il est passé de sans-abri à millionnaire en investissant dans le bitcoin" ou "Un agent immobilier de Second Life gagne 1 million de dollars" donnent l'impression que le travail dans l'économie de l'information numérique peut être lucratif, même pour les personnes non qualifiées (WFTX Webstaff 2018 ; Boyes 2006). Dans presque tous les cas, ces types d'emplois semblent être des alternatives raisonnables au travail manuel et au travail de service dans les villes qui étaient autrefois construites autour des usines. Ces récits sur les créatifs ont été particulièrement attrayants pour les personnes chargées de développer les économies locales au cours de la majeure partie des 30 dernières années, mais l'engagement envers ces mythes populaires a atteint une sorte de fièvre au début des années 2000. Les universitaires, les capitalistes de la Silicon Valley et d'autres ont réagi à des décennies d'externalisation et de délocalisation d'usines à l'étranger et au-delà des frontières nationales, en trouvant des idées telles que l'"économie de la connaissance" et l'"économie de l'information" particulièrement convaincantes pour encadrer le travail de l'ère post-factorielle dans des endroits comme les États-Unis. D'une manière générale, de nombreux Américains, Australiens et Européens en sont venus à penser que les emplois créatifs pouvaient remplacer le travail en usine d'une époque révolue.
Quoi que les créatifs fassent en pratique, les histoires à leur sujet ont tendance à impliquer une culture progressiste de la Silicon Valley qui permet à n'importe qui de gagner de l'argent grâce au mérite de ses bonnes idées. Richard Florida est peut-être le penseur le plus influent parmi un groupe d'intellectuels publics qui cultivent la réputation d'envisager un avenir utopique du travail sur le World Wide Web. Au début des années 2000, Florida était un chercheur en études urbaines dont la thèse était simple et incendiaire : "la croissance économique régionale est déterminée par les choix d'implantation des personnes créatives - les détenteurs du capital créatif - qui préfèrent des lieux diversifiés, tolérants et ouverts aux nouvelles idées" (2002 : 223). Du point de vue de Florida, les entreprises modernes étaient redevables des désirs des créatifs dont la capacité de créativité "ne peut être achetée et vendue, ou activée et désactivée à volonté" (2002 : 5). Bien que largement critiquées, ses idées sur la "classe créative" ont validé certains stéréotypes progressistes sur les jeunes, tout en offrant des recommandations politiques relativement simples pour les développeurs urbains aux États-Unis et dans toute l'Europe (Sternberg 2013 ; Long 2009 : 210). Florida a soutenu que les urbanistes devraient développer des infrastructures sociales et matérielles qui attireraient les créatifs et donc les entreprises modernes.
Florida a simplifié sans esprit critique la raison pour laquelle des entreprises technologiques comme Apple pensaient qu'il serait rentable d'exploiter le travail créatif en col blanc de personnes concentrées dans des "paradis hippies" - des endroits où les hommes d'affaires étaient prêts à s'approprier les idéaux et les pratiques de "types technologiques excentriques de Berkeley et Stanford" (2002 : 204-205). Selon Florida, dans ces havres, les entreprises et les industries de haute technologie fusionnent les valeurs bohémiennes et l'éthique protestante du travail - "l'ethos créatif" - en une force motrice qui pourrait ensuite être reproduite dans la plupart des environnements de travail faisant appel aux modes de vie de la culture de consommation (2002 : 207). Les promoteurs urbains ont même mis en œuvre plusieurs de ses recommandations, mais ce qu'il avait prédit dans son premier ouvrage ne s'est en fait pas produit, comme l'ont observé depuis de nombreux chercheurs (Sternberg 2013 : 308 ; Krätke 2010 : 2 ; Peck 2005 : 759). En y regardant de plus près, l'argument de Florida était erroné parce qu'il s'appropriait des aspects superficiels de l'histoire culturelle du logiciel et de l'informatique du milieu du siècle et naturalisait les réussites des élites de l'économie numérique et du travail de la Silicon Valley dans un effort malavisé pour plaider en faveur de l'adoption contemporaine de politiques progressistes de développement spatial et microéconomique.
La vision positive de Florida sur le rôle des créatifs n'est qu'un exemple canonique des imaginaires sociotechniques répandus sur les technologies numériques et les personnes qui les utilisent. Selon Jasanoff et Kim, les imaginaires sociotechniques sont "des formes collectivement imaginées de la vie sociale et de l'ordre social reflétées dans la conception et la réalisation de projets scientifiques et/ou technologiques spécifiques à une nation" (2009 : 120). Ces imaginaires sous-tendent les arguments normatifs sur l'action personnelle et le pouvoir technologique, et ils reflètent les idéologies communément exprimées sur l'avenir des technologies numériques et des personnes qui les utilisent. Deux de ces imaginaires sont le techno-utopisme et le techno-libertarisme. Le techno-utopisme est aussi parfois connu sous le nom de déterminisme technologique ; il s'agit d'une croyance selon laquelle les technologies peuvent résoudre les problèmes que les gens perçoivent dans la société. Le techno-libertarianisme est une philosophie économique et politique qui combine les idéaux libertaires et les principes politiques du marché libre, en particulier dans le contexte du commerce électronique, un terme inventé pour la première fois par Paulina Borsook (Borsook 2000 : 2 ; Steinmetz et Gerber 2015 : 32).
Les premiers travaux ont eu tendance à regrouper le techno-utopisme et le techno-libertarisme sous le nom d'"idéologie californienne", en référence à l'"esprit de liberté des hippies et au zèle entrepreneurial des yuppies", dont les croyances semblent avoir façonné le développement des industries de haute technologie liées à la Silicon Valley entre 1960 et 1996 (Barbrook et Cameron, 1996). En tandem, le techno-utopisme et le techno-libertarisme encouragent les scientifiques et les hommes d'affaires à résoudre les problèmes sociaux en investissant, en développant et en distribuant des technologies parce que toutes ces technologies élimineront vraisemblablement les obstacles au progrès social et atténueront les conflits sociaux. Ces scientifiques et ces hommes d'affaires pensent qu'une fois la technologie inventée, le seul dilemme est de s'assurer que les gens y auront accès. Une fois que les gens y auront accès, soit ils résoudront eux-mêmes le problème, soit la technologie le fera à leur place. Les historiens de la technologie s'empresseraient de souligner que le techno-utopisme et le techno-littéraire sont bien plus anciens que la révolution numérique - personne dans la Silicon Valley ne les a inventés ; cependant, la popularité de ces idées aide à expliquer les changements d'attitude des gens à l'égard du travail numérique et des technologies informatiques au cours du XXe siècle (English- Lueck 2017 ; Toyama 2015 ; Ensmenger 2010 ; Turner 2010).
Historiquement, les études ethnographiques et historiques sur le travail numérique ont eu tendance à étudier l'informatique personnelle et le travail numérique dans les pays occidentaux, et donc à s'engager dans des présupposés occidentaux sur la nature du travail et de la liberté. Alors qu'aujourd'hui, il est plutôt banal pour certaines personnes de considérer les ordinateurs personnels comme des symboles de liberté personnelle, des chercheurs tels que Paul Edwards et Fred Turner nous rappellent qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Pendant la guerre froide, les ordinateurs étaient généralement décrits comme des symboles de commandement et de contrôle militarisés aux États-Unis. Les inquiétudes du public à l'égard de ces technologies apparaissaient souvent dans des films populaires tels que 2001 : l'Odyssée de l'espace (1968), Star Wars (1977) et The Termina- tor (1984) - des histoires de personnes luttant contre un système dominateur gardé et renforcé par la technologie (Edwards 1997 : 311). Pendant et immédiatement après la guerre froide, cette rhétorique est lentement passée d'un discours en vase clos à une vision techno-utopique selon laquelle les ordinateurs en constante prolifération annonçaient l'arrivée d'une société "décentralisée, égalitaire, harmonieuse et libre" (Turner 2010 : 1, 16 ; Edwards 1997 : xiii). Comment expliquer cette transformation ?
Pour Turner, rien dans ce changement idéologique n'était naturel, et il écrit : " il n'y a rien à propos d'un ordinateur ou d'un réseau informatique qui exige nécessairement qu'il nivelle les structures organisationnelles, qu'il rende l'individu plus entier psychologiquement, ou qu'il conduise à l'établissement de communautés intimes, bien que géographiquement distribuées " (2010 : 3, accentuation dans l'original). Les idéologies médiatiques des ordinateurs n'ont pas été déterminées par des propriétés inhérentes aux appareils ou par les préférences rationnelles des gens pour les meilleures technologies disponibles à l'époque. Les gens ne décident pas soudainement de penser différemment à propos des formes de communication médiatisées par ordinateur ; quelqu'un ou un groupe doit aider à créer des croyances et des pratiques partagées largement répandues par le biais d'une action collective. Cet effort collectif exige plus que la viralité d'une bonne idée ; l'idée doit être soutenue par une infrastructure complémentaire afin que ces idées puissent être concrétisées sous une forme matérielle. La plateforme de médias sociaux Twitter, par exemple, pourrait demander à tous ses utilisateurs de limiter la quantité de données qu'ils partagent dans un seul tweet. Elle pourrait le demander très gentiment. Mais la plupart des gens ne le feront pas ou ne sauront pas comment limiter le nombre de mots ou de caractères dans un tweet sans qu'il y ait une limite stricte à ce qui est autorisé.
Les ingénieurs de Twitter peuvent aider les utilisateurs à évaluer leurs tweets avant de les partager en leur fournissant une représentation graphique du nombre de caractères utilisés dans un projet de tweet. Dans ce cas, les ingénieurs tentent de s'assurer que les croyances idéologiques et les attentes des utilisateurs de Twitter complètent la façon dont ils ont conçu l'infrastructure du moyen de communication. Il s'agit là aussi d'une forme de travail numérique qui doit accompagner les technologies récemment introduites afin que davantage de personnes soient disposées à adopter ces médias. La culture contemporaine de la Silicon Valley est aujourd'hui largement répandue en partie parce qu'un groupe restreint d'entrepreneurs et de journalistes très influents a amplifié les philosophies et les pratiques sociales de la Silicon Valley en publiant deux périodiques importants : le Whole Earth Catalog (qui devient une graine et un modèle pour les premières et les plus influentes communautés virtuelles à ce jour et qui est le fruit du travail de Stewart Brand) et le magazine Wired (Turner 2010 : 141, 207). Les personnes à l'origine du Whole Earth Catalog ont contribué à établir des accords largement partagés sur ce à quoi le travail devrait ressembler. Lors des premiers tirages de la publication en 1968-1972, pratiquement toutes les personnes qui produisaient le catalogue étaient blanches, jeunes, financièrement à l'aise et avaient reçu une éducation formelle (Turner 2010 : 100).
Ils ont utilisé le catalogue pour partager des informations sur la science, la technologie, les religions orientales, le "mysticisme acide" et la théorie sociale communautaire ; les lecteurs ont également contribué à des écrits qui "célébraient le travail entrepreneurial et les formes hétéroclites d'organisation sociale, promouvaient la communauté désincarnée comme un idéal réalisable, et suggéraient que les systèmes techno-sociaux pouvaient servir de sites de communion extatique" (Turner 2010 : 73). Le Whole Earth Catalog a défendu l'idée que les ordinateurs et les réseaux informatiques pouvaient servir d'outils de libération dans la construction de la société (2010 : 72). À l'époque, la libération était un projet politique convaincant pour deux raisons. Premièrement, beaucoup craignaient de vivre dans une société où la valeur d'une personne était liée à sa volonté et à sa capacité à accomplir des tâches standardisées et routinières de l'économie numérique et du travail. Deuxièmement, certains pensaient que de nombreuses institutions sociales étaient devenues trop grandes et trop puissantes pour que les individus puissent autodéterminer leur vie et façonner leur environnement (Turner 2010 : 82). En fin de compte, le Whole Earth Catalog et son forum en ligne, The WELL, ont modelé des "infrastructures rhétoriques et sociales" - littéralement, de nouveaux systèmes d'information (magazines, réunions et rencontres en ligne) qui ont contribué à légitimer et à populariser des structures organisationnelles plates, des contrats de travail à court terme, des contrats basés sur des projets et des réseaux sociaux néolibéraux (Turner 2010 : 239).
Pour les spécialistes des études sur le travail numérique, l'histoire des entreprises de la Silicon Valley et des mouvements de la contre-culture illustre l'origine des mythes et des croyances populaires sur le travail créatif, mais elle tend également à normaliser qui est considéré comme un travailleur numérique et ce qui est considéré comme un travail numérique. Pour la plupart des historiens, la définition d'un créatif ou d'un travailleur numérique sera façonnée par les histoires que les dirigeants de l'industrie se racontent à eux-mêmes, car les historiens s'appuient en partie sur des documents d'archives pour leur analyse. Par conséquent, les historiographies peuvent parfois amplifier les vérités partielles inhérentes à leurs documents d'archives. En particulier, les histoires industrielles ont tendance à attribuer sélectivement le mérite aux personnes produisant une marchandise, et elles privilégient souvent les récits expliquant le succès de l'entreprise par les décisions et les expériences de personnes et d'entreprises spécifiques. Par exemple, les histoires d'origine de la Silicon Valley ont tendance à surdéterminer le rôle des "bonnes idées" et à ignorer la relation d'interdépendance entre les travailleurs dépendant de l'informatique et d'autres industries de services et de fabrication (Ekbia et Nardi 2017 : 23 ; Matthews 2003 : 229 ; Pellow et Park 2002 : 3). Classer les personnes en tant que travailleurs numériques Pourquoi se donner la peine de distinguer les travailleurs des travailleurs numériques ?
Suivant une rubrique tout aussi étroite, les travailleurs numériques étaient autrefois considérés comme "les leaders de la communauté AOL, les 224 programmeurs open source Iris Bull et Ilana Gershon, les concepteurs Web amateurs, les éditeurs de listes de diffusion et les NetSlaves prêts à "travailler pour des cappuccinos" juste pour l'excitation et les promesses douteuses du travail numérique" (Terranova 2000 : 51). Ce schéma persiste largement pour les chercheurs qui suivent la tradition marxiste autonomiste italienne. Popularisée par Hardt et Negri dans leur célèbre ouvrage Empire, cette école de pensée maintient la continuité entre les analyses du travail en usine et du travail créatif (comme celui effectué dans les usines sans murs) en analysant si la valeur a été produite à partir du travail immatériel - des activités qui produisent de la plus-value, de la production et de la gestion de la communication et des symboles (Dyer-Witheford et De Peuter 2009 ; Gill et Pratt 2008, Hardt et Negri 2001). Le terme "immatériel" décrit spécifiquement des activités que l'on ne verrait pas nécessairement dans une usine ou une ferme, mais qui sont facilement observables dans un bureau ou un studio d'art. Le travail en usine peut être vulnérable à l'automatisation, mais le travail immatériel n'y résiste pas totalement. Selon l'application, un programme informatique peut permettre à quelqu'un de rendre "automatiquement" un art unique, de traduire d'une langue à l'autre ou de modérer un contenu offensant.
Dans tous les cas, la valeur du travail dépend de la manière dont les travailleurs jugent ce qui est bon ou mauvais, ce qui est bien ou mal, afin de s'assurer que les systèmes fonctionnent comme prévu. Les études sur le travail immatériel offrent aux chercheurs un moyen de délimiter les types de travail en utilisant des qualités supposées inhérentes à chaque tâche, en utilisant l'idée de la créativité individuelle comme un aspect innovant de certaines formes de travail informatisé (Barada et Primorac 2018 : 130). Toutefois, les détracteurs de ce système soutiennent que les concierges, les ouvriers mécaniques et les agriculteurs font preuve de créativité lorsqu'ils travaillent, même s'ils ne sont pas rémunérés directement pour ces pensées (Zlolniski 2006 : 75). Certains chercheurs affirment que la valorisation du travail sur la base de l'idée que les gens se font de la créativité peut conduire les gens à attribuer à tort le succès des entreprises de haute technologie ou de l'économie de la connaissance à quelques personnes travaillant au sommet d'une organisation (Nakamura 2014 : 936 ; King 2010 : 293). Pour ceux qui critiquent les récits de la Silicon Valley sur le travail et le succès, la définition du travailleur numérique est devenue plus inclusive au fil du temps pour inclure les personnes de la classe ouvrière qui soutiennent, nettoient et s'occupent des célébrités de l'industrie de la haute technologie (Dyer-Witheford 2015 : 128).
Ces chercheurs étudient depuis des décennies les chaînes d'approvisionnement mondiales qui soutiennent des lieux comme la Silicon Valley, établissant une corrélation constante entre le succès des entreprises sur le marché et les violations des droits de l'homme, le racisme et le sexisme systémiques sur le lieu de travail, la fatigue chronique et l'épuisement professionnel, les domaines favorables en matière de droit de la propriété intellectuelle et la pollution de l'environnement. Comme l'a démontré Lisa Nakamura, ces stratégies industrielles sont évidentes dans les archives de Fairchild Semiconductor, une entreprise pionnière de l'électronique dont les usines produisaient initialement des circuits intégrés en Amérique du Nord (2014 : 921). Fairchild a exploité une usine d'assemblage de semi-conducteurs à Shiprock, au Nouveau-Mexique, de 1965 à 1975, parce que la direction pensait pouvoir exploiter "la flexibilité et la dextérité inhérentes des Indiens" - dont l'expérience en matière de tissage et d'orfèvrerie suggérait une capacité à produire des conceptions de circuits intégrés, et qui n'étaient pas protégés par les lois américaines sur le salaire minimum (Nakamura 2014 : 926).
Économie numérique et travail
Si, selon Nakamura, nous acceptons la définition de Nick Montfort et Ian Bogost d'une plateforme comme " tout ce que le programmeur prend pour acquis lorsqu'il développe, et tout ce que, d'un autre côté, l'utilisateur est tenu de faire fonctionner pour utiliser un logiciel particulier ", alors l'inclusion catégorique des ouvrières d'usine navajo dans la définition du travailleur numérique rend honnêtement compte des conditions matérielles requises pour la création d'appareils de médias numériques : l'existence d'une main-d'œuvre féminine bon marché (2014 : 936). En tant que stratégie analytique pour compter le travailleur numérique, l'étude des chaînes de production mondiales permet aux chercheurs de se concentrer sur une grande variété d'industries et d'emplois techniques. Fuchs et Sandoval reconnaissent la portée de cette analyse lorsqu'ils comparent les professions des différentes personnes qu'ils ont incluses dans leur étude : Les vies professionnelles de Muhanga, Lu, Bopha, Mohan, Bob et Ann semblent complètement différentes. Muhanga extrait des minéraux de la nature. Lu et Bopha sont des travailleurs industriels. Mohan, Bob et Ann sont des travailleurs de l'information qui créent des logiciels ou des dessins. Ils travaillent dans des conditions différentes, telles que l'esclavage, le travail salarié ou le travail indépendant. Pourtant, ils ont en commun le fait que leur travail est lié de différentes manières à la production et à l'utilisation des technologies numériques et que les entreprises du secteur des TIC en tirent profit.
Pour Fuchs et Sandoval et d'autres, investis dans une définition large du travailleur numérique, les chercheurs devraient inclure les personnes dont le travail peut parfois être invalidé comme étant plus fonctionnel que créatif (2014 : 488). Une définition inclusive classe les travailleurs en fonction de la manière dont les produits du travail satisfont les besoins (valeurs d'usage) liés aux technologies des médias numériques. Étudier les travailleurs en fonction de leur statut de créatifs tend à surestimer le rôle que les talents individuels et les personnes jouent dans les schémas de recherche de profit des entreprises internationales. En utilisant une terminologie plus inclusive, les chercheurs sont mieux placés pour comparer les expériences des personnes dont le travail constitue une sorte de service informatique - des joueurs professionnels de jeux vidéo de sport électronique et des streamers aux Amazon Mechanical Turkers, des hackers aux entrepreneurs de logiciels, et des fabricants de semi-conducteurs aux travailleurs des services de l'économie gigogne (Greene et Joseph 2015 : 240 ; Irani 2015 : 226). Bien entendu, l'un des défis inhérents à une définition large est de savoir comment et où tracer la ligne de démarcation entre ce qui constitue un travail pour une entreprise à but lucratif. Ce défi est particulièrement visible pour les chercheurs qui étudient la production médiatique dans un contexte en ligne, où la distinction entre travailleur et fan peut s'estomper considérablement. Parfois, les choses que les fans font les uns pour les autres produisent de la valeur pour les entreprises.
Certains fans créent des éléments artistiques supplémentaires pour un jeu ou gèrent un forum culturel en ligne autour d'une franchise ou d'un média spécifique, et ils le font sans aucune incitation ou compensation de la part de l'entreprise de médias propriétaire. En effet, des personnes qui sont généralement considérées comme de simples consommateurs participent à la commercialisation et à la production d'actifs nouveaux et inédits pour un produit dont la base de fans ou d'utilisateurs est bien établie.3 226 Iris Bull et Ilana Gershon Playbour C'est au début et au milieu des années 2000 que les chercheurs ont pris note de cette éthique étrange, proche du bénévolat, au sein des groupes de fans et qu'ils ont décidé de classer les activités non rémunérées et productrices de valeur sous le terme de playbour, afin de tenir compte des divisions floues entre les loisirs et le travail. Julian Kücklich a inventé ce terme pour caractériser le travail non rémunéré des consommateurs pour les industries du divertissement (Kücklich 2005). Kücklich a observé que les entreprises de jeux vidéo ne trouvaient pas rentable de développer la propriété intellectuelle en raison des coûts de production élevés. Cherchant une alternative, certaines entreprises tirent profit de la cul- tivisation de joueurs fans qui créent gratuitement du contenu distribuable pour une communauté de joueurs plus large, allant parfois jusqu'à concevoir et distribuer eux-mêmes des mods. Les mods transforment généralement les ressources disponibles telles que les cartes, les skins disponibles et les sons dans un environnement virtuel.
Leur fabrication requiert un niveau de compétence technique non négligeable. Pourquoi quelqu'un ferait-il ce genre de travail gratuitement ? Quelques fan-programmeurs affirment qu'ils aiment créer le contenu, qu'ils le considèrent comme une formation professionnelle ou qu'ils veulent soutenir leur communauté en ligne (Postigo 2007 : 311). Pour Kücklich, le fait de qualifier une telle activité de forme de travail reconnaît la manière dont ces activités fonctionnent idéologiquement pour extraire de la valeur. Qualifier une activité de travail ludique peut être un acte politique, car cela peut encourager les gens à s'interroger sur les types d'activités qui devraient justifier une juste rémunération. Pour certains chercheurs, la préoccupation actuelle est de savoir comment l'informatique et les technologies numériques de travail en réseau médiatisent le travail en tant que relation sociale. Tiziana Terranova, qui s'inscrit dans la tradition marxiste autonomiste, est bien connue pour avoir soutenu que ce que l'on appelle le travail gratuit permet de maintenir les industries culturelles dans les sociétés capitalistes avancées où l'internet favorise "une flexibilité accrue de la main-d'œuvre, une requalification continue, le travail en free-lance et la diffusion de pratiques telles que le complément de salaire (apporter du travail supplémentaire à la maison à partir du bureau conventionnel)" (2000 : 34). Les idées populaires sur le travail salarié pourraient être en train de changer en raison de la façon dont les gens utilisent Internet pour le commerce. Si c'est le cas, nous devrions peut-être commencer à rémunérer les personnes pour les activités qui fonctionnent comme un travail pour quelqu'un.
Il peut y avoir un problème si nous nous concentrons uniquement sur les normes sociales et les attentes établies en matière de rémunération. Ces normes ne sont peut-être pas assez souples pour tenir compte de la mesure dans laquelle les capitalistes extraient de la valeur de leurs travailleurs et, accessoirement, de toutes les traces numériques qui peuvent être réaffectées et vendues à des fins lucratives. Les entreprises tirent souvent de la valeur des activités soutenues et pénibles que les joueurs ou les utilisateurs effectuent dans le cadre de leur utilisation quotidienne d'un support de plateforme, et pas seulement des mods de jeux vidéo. Ekbia et Nardi parlent de ce type de pratiques comme d'un travail hétéromodifié, arguant que les jeux vidéo, les médias sociaux et les applications de crowdsourcing reposent paradigmatiquement sur la médiation et l'accomplissement de tâches critiques par les utilisateurs finaux pour qu'une plateforme techno- logique fonctionne et remplisse l'objectif visé (2014). Les développeurs conçoivent souvent des plateformes en ligne qui dépouillent les joueurs de manière informelle pour créer une communauté en ligne souhaitable. La valeur monétaire de ce travail est souvent difficile à quantifier. Pourtant, les gens apprennent l'importance de ces tâches en ligne lorsqu'elles ne sont pas effectuées (Gillespie 2018). Sans une intervention humaine constante, les personnes et les robots automatisés ont tendance à polluer le support d'une plateforme avec du spam, des comportements tabous et des discours offensants - en bref, un comportement toxique. Économie numérique et travail 227 Dans les environnements de jeux vidéo compétitifs, les joueurs et les développeurs de jeux parlent souvent de leur perception de la toxicité et de la façon dont celle-ci tend à nuire à la viabilité de la plateforme pour les utilisateurs.
Comme Bull l'a observé dans une étude en cours sur les joueurs d'Overwatch, lorsque les gens discutent du comportement toxique d'un joueur, ils font souvent référence à un sentiment d'effondrement de l'infrastructure, où le contenu perçu du jeu interfère avec leur plaisir ou entrave leur progression dans une arène compétitive. Lorsque la toxicité est synonyme de cyberintimidation, les réponses de Bull et un certain nombre de forums en ligne indiquent que la toxicité les décourage de continuer à jouer au jeu. Les joueurs dits toxiques les laissent souvent dans un état de colère, de dépression, de marginalisation et de déshumanisation. Dans ces moments-là, pour les joueurs, les actions des autres utilisateurs ne se distinguent pas des autres aspects du jeu. Certains joueurs réagissent à la toxicité en quittant tout simplement la plateforme, mais d'autres développent des projets d'infrastructure communautaire alternatifs pour subvertir les limites de la conception d'Overwatch. Overwatch est un jeu multijoueur qui ne fonctionne bien que lorsque tous les joueurs agissent de bonne foi pour atteindre les objectifs et résoudre des problèmes stra- tégiques complexes en équipe. Certaines femmes consacrent d'innombrables heures à développer des communautés Overwatch compétitives hors plateforme afin de mieux contrôler avec qui elles jouent, surtout après que leurs propres coéquipiers ont saboté leurs parties par sexisme.
Ces femmes mettent en place et gèrent une petite communauté de personnes sur un serveur Discord, par exemple, pour éviter les acteurs de mauvaise foi sur l'échelle compétitive qui saboteront les objectifs de l'équipe lorsqu'ils se rendront compte qu'ils jouent dans la même équipe qu'une femme (ou quelqu'un qui ressemble à une femme). Elles produisent aussi souvent des vidéos, des podcasts, des guides écrits, etc. qui fournissent un contenu éducatif que les joueurs de leur communauté peuvent examiner et étudier. Ces efforts sont joués, car le contenu pédagogique permet aux utilisateurs de la plateforme de mieux comprendre comment s'entraîner dans leurs simulations de combat. Cependant, il s'agit également d'un travail hétérogène, car il sert de moyen pour distribuer le contenu aux joueurs en premier lieu. Les environnements de jeux vidéo compétitifs mettent souvent en évidence l'utilité variable de la séparation catégorielle du travail et du jeu par une frontière invisible ou imaginaire - les activités en ligne ont tendance à osciller constamment entre ces catégories. Pour une personne extérieure, les jeux peuvent même apparaître comme ce lieu idéal où "travailler pour rien est devenu normatif, en grande partie parce que ce n'est pas vécu comme de l'exploitation" (Ross 2013 : 24-25). Dans ces contextes, cependant, les concepts de playbour et de travail hétéromodifié pourraient aider les chercheurs à s'interroger sur la manière dont les entreprises conçoivent des environnements sociaux médiatisés pour brouiller intentionnellement les frontières entre le travail et le jeu et obscurcir la valeur dérivée de la participation individuelle.
Les critiques du travail ludique ressemblent aux préoccupations concernant la théorie du travail gratuit : les deux approches supposent que toutes les activités qui équivalent à un travail devraient être rémunérées par de l'argent. Pour ces chercheurs, le travail est une activité qui a une valeur inhérente, qui peut être donnée et exister en dehors du marché (Hesmondhalgh 2010). Les chercheurs peuvent s'enfermer dans une analyse réductrice en laissant entendre que toute activité qui procure un avantage à autrui devrait être rémunérée ; ils commencent à s'inquiéter de l'envoi de vidéos sur Snapchat au lieu de se concentrer sur l'augmentation des nouvelles formes de gestion de la propriété intellectuelle. un certain point, Hesmondhalgh affirme que la recherche radicale de conditions de travail éthiques peut occulter les mécanismes utilisés par les capitalistes pour faire des affaires dans les industries culturelles créatives (2010 : 279). Les chercheurs pourraient oublier de se demander pourquoi il est nécessaire de rémunérer les gens avec de l'argent. Le concept de playbour est devenu important dans les études de production de jeux vidéo et central dans l'étude de la gamification en tant qu'approche théorique généralisée. Les chercheurs qui étudient le playbour ou la gamification s'appuient souvent sur l'ethnographie pour examiner la fonction du plaisir dans le travail. Lorsqu'un ethnographe entreprend d'étudier le processus de production d'un jeu vidéo, il s'engage généralement dans un travail de terrain multisite.
Ils vont dans les coulisses et parlent aux développeurs de logiciels qui créent et entretiennent l'environnement virtuel, mais ils s'appuient également sur leur expérience directe en habitant un avatar dans le jeu, en participant à des forums en ligne, en consommant des projets multimédias créés par des fans et en étudiant des ressources en ligne sur ce monde virtuel (Boellstorff 2015 ; N. Taylor et al. 2015 ; T. L. Taylor 2009). Les chercheurs s'attachent à distinguer et à comprendre comment les processus sociaux et techniques régissent la vie sociale et informent les expressions de la créativité (Shaw 2015 ; Stabile 2014 ; Bull 2014 ; Chee 2006). Les études industrielles sur les mondes virtuels et les sociétés de production de jeux vidéo tendent à décrire les conditions de travail des développeurs de jeux professionnels et les chaînes d'approvisionnement mondiales qui soutiennent l'industrie du jeu vidéo (Banks et Cun- ningham 2016 ; O'Donnell 2014). Ces systèmes sont souvent soutenus par des systèmes de récompense manufac- turés et des marchés artificiellement maintenus pour les biens et services échangés dans le cyberespace (Malaby 2009). La production de jeux vidéo semble parfois être un domaine industriel particulièrement excitant parce que les développeurs de jeux sont typés comme une race passionnée, pleine d'abnégation, et les produits qu'ils fabriquent sont souvent facilement exploitables avec des micro-transactions et des articles cosmétiques de l'avatar d'un joueur.
Mais comme l'a observé Thomas Malaby dans une ethnographie des marchandises virtuelles dans Second Life de Linden Lab, cette perspective positionne les joueurs comme des utilisateurs temporaires et les biens virtuels comme des pos- sessions pas plus achetables que les putters que l'on loue dans un parcours de golf miniature (2009 : 18). La situation sur le terrain est souvent un peu plus compliquée, car les joueurs trouvent souvent de la valeur dans les services (peu importe qui les offre) qui les aident à se différencier socialement des autres joueurs (Malaby 2009 : 20). Et si les possibilités offertes par les mondes virtuels ont permis de réduire et d'alléger les coûts transactionnels qui pèseraient sur l'échange de biens matériels, les marchandises virtuelles émergent souvent de situations sociales nécessitant un contact humain. Dans l'ensemble, les mondes virtuels n'ont pas incité les gens à inventer de nouveaux biens et services ; ils ont changé la façon dont les relations entre les humains et les nonhumains, les codes et les lois sont établis tout en gérant les risques et les récompenses (Malaby 2009). Ces relations ne sont pas seulement façonnées par les possibilités numériques, mais aussi par les lois et coutumes régionales relatives au comportement professionnel sur le lieu de travail et à la production de médias.
Les spécialistes de la production de jeux vidéo ont tendance à étudier comment les histoires locales et les environnements matériels peuvent caractériser les cultures de travail différemment sur chaque continent connecté à Internet. T. L. Tay- lor a étudié les jeux informatiques professionnalisés et compétitifs, par exemple, et a démontré comment les joueurs, les cultures de jeu et les professionnels du divertissement sont influencés par des mécanismes de structuration spécifiques à la région (tels que les équipes, les ligues, les diffuseurs) et des infrastructures préexistantes (telles que les connexions réseau, les règles de jeu, les lieux de tournoi) (2012). D'autres chercheurs ont élaboré des théories pratiques sur la manière dont le jeu et le travail sont liés à l'utilisation des technologies en étudiant les relations complexes entre les joueurs, les développeurs de jeux et les technologies numériques. Certains chercheurs considèrent que les technologies numériques ouvrent la voie à une nouvelle ère de production de marchandises et à un nouveau régime de principes de gestion scientifique par le biais de la gamification, et ce faisant, ils suivent une trajectoire intellectuelle différente des analyses du travail ludique et du jeu en tant que travail. La gamification décrit à la fois un processus d'application de principes de conception de jeux dans l'exécution de tâches qui ne sont pas des jeux et une stratégie commerciale pseudo-légitime visant à développer de nouvelles sources de revenus.
La plupart des gens, lorsqu'ils entendent parler de gamification pour la première fois, reçoivent une version abrégée de la croyance selon laquelle le plaisir peut être intégré dans n'importe quelle tâche, et que toute tâche amusante peut augmenter l'engagement et le plaisir de quelqu'un. Les explications plus nuancées de la gamifica- tion tendent à développer l'utilisation spécifique de certains principes de conception de jeux dans la refonte des stratégies de gestion de l'information et d'organisation des tâches. Des hypothèses sont émises sur la manière dont les concepts de conception de jeux sont liés à des expériences universelles de plaisir ou de jeu. En effet, la question de savoir quels principes de conception de jeux sont réellement importants est généralement débattue. Peu de chercheurs ont acquis autant de notoriété dans la traduction de ces concepts que Jane McGonigal, une prévisionniste de l'avenir, conceptrice de jeux et chercheuse en études de la performance, dont les travaux illustrent le fonctionnement typique de ces débats. Elle a explicitement tourné en dérision la gamification en la qualifiant d'application erronée de points, de niveaux, de classements et de badges de réussite. Dans le même temps, McGonigal défend ses propres principes de "conception ludique", tels que "l'émotion positive, les relations, le sens [et] l'accomplissement" (2011).
Si, pour McGonigal, il existe des distinctions significatives entre l'adoption de systèmes de récompense extrinsèques et intrinsèques, cette distinction nuancée échappe souvent à d'autres chercheurs qui identifient plus largement la gamification comme un ensemble de mécanismes destinés à exploiter les consommateurs (Bogost 2014 ; M. Fuchs et al. 2014 : 10). Les techniques de gamification sont souvent légitimées par des personnes qui soutiennent que les développeurs s'efforçaient de bonne foi d'accomplir de bonnes tâches ou des tâches inoffensives. Les plateformes de distribution de travail en ligne Les plateformes de distribution de travail contemporaines illustrent un ensemble différent de questions relatives à la manière dont les technologies reconfigurent l'organisation sociale de formes particulières de travail. Pour les spécialistes des études sur le travail numérique, les plateformes de distribution de travail en ligne modifient la structure hiérarchique des tâches d'attribution du travail et nécessitent une étude ethnographique pour comprendre comment les gens conçoivent les technologies et mettent en œuvre des normes sociales particulières pour transformer les efforts des travailleurs numériques en profit. Nombreux sont ceux qui connaissent certaines de ces plateformes, comme Uber, Amazon MTurk, TaskRabbit et Upwork, qui s'inscrivent toutes dans la catégorie plus large des plateformes de distribution du travail parce qu'elles permettent aux demandeurs et aux chercheurs de travail d'y participer. Les demandeurs de travail choisissent de solliciter ou non du travail sur ces plateformes et les demandeurs de travail sélectionnent les tâches qu'ils souhaitent effectuer.
Cela contraste avec la plupart des emplois, où l'employeur choisit généralement l'employé et lui assigne des tâches. Sur ces plateformes de distribution du travail, les demandeurs demandent si quelqu'un est intéressé par une tâche donnée, souvent pour un prix fixé à l'avance ou en demandant une offre, et les travailleurs choisissent les tâches qu'ils sont prêts à effectuer. Par exemple, sur TaskRabbit (récemment racheté par IKEA), vous pouvez demander à quelqu'un de venir chez vous pour monter une étagère que vous venez d'acheter ou de faire la queue pour obtenir des billets pour un concert. Ces tâches sont organisées en ligne, mais pas nécessairement exécutées en ligne. Et toutes les tâches ne sont pas effectuées par une seule personne. Dans certains cas, une foule est rassemblée pour effectuer le travail, en utilisant la technologie pour coordonner les tâches individuelles. Sur d'autres plateformes, bien que la possibilité d'effectuer une tâche contre rémunération soit ouverte à une foule, la tâche réelle sera effectuée par une seule personne qui, selon la plateforme, peut ou non avoir été explicitement sélectionnée par le demandeur de travail à l'avance. Ces plateformes rendent visible une partie du travail social qui entre dans la composition des emplois, travail social qui tend à être méconnu.
Pour illustrer cela, nous nous appuyons sur un article d'Ilana Gershon et Melissa Cefkin qui traite des recherches que Cefkin et son équipe ont menées chez IBM sur la manière dont les gens intègrent les plateformes de distribution du travail dans les rythmes quotidiens de répartition de la main-d'œuvre au sein des entreprises (voir également Cefkin, Anya et Moore 2014). Cefkin et son équipe ont voulu étudier des personnes habituées à ce que leurs rôles professionnels déterminent les tâches qu'elles doivent accomplir, et voir ce qui se passerait lorsqu'on leur demanderait de s'engager dans un système qui leur permettrait de choisir les tâches qu'elles souhaitent accomplir indépendamment d'un rôle spécialisé. Cette recherche a révélé que lorsque les gens demandent du travail, ils doivent tenir compte de la façon dont les tâches sont divisées en unités distinctes. Ils doivent également déterminer comment segmenter le travail, en anticipant la manière dont les produits résultants voyageront et seront recombinés. Comme l'a expliqué succinctement un demandeur de travail, "à un membre de l'équipe retenue, je peux simplement dire 'brouiller un œuf', alors qu'à un joueur [du système de travail collaboratif], je dois dire 'ouvrir le réfrigérateur', 'enlever la boîte d'œufs', 'ouvrir la boîte d'œufs', 'enlever un œuf', etc. En bref, les plates-formes donnent naissance à de nouvelles façons de concevoir le travail, soit en divisant le travail en morceaux et en parties, soit en laissant les tâches assemblées de façon plus holistique comme des ensembles unifiés, en transférant le travail consistant à trouver comment l'accomplir pour qu'un autre puisse l'effectuer. Si l'on s'y prend mal, le travail demandé peut être inutilisable.
Par exemple, Melissa Cefkin a interrogé un demandeur de travail qui a utilisé l'une de ces plateformes pour trouver quelqu'un capable d'effectuer la tâche apparemment simple d'extraire des adresses d'un ensemble de données pour les intégrer dans un courrier électronique de masse. Cependant, elle n'avait pas précisé l'objectif ou la forme de livraison préférée dans les spécifications du travail, de sorte que les résultats qu'elle a reçus n'étaient pas correctement formatés pour son système de messagerie électronique. Les membres de son équipe locale auraient déjà su pourquoi elle voulait ces informations et auraient anticipé la meilleure façon de fournir les résultats s'ils avaient exécuté la tâche plutôt que de faire appel à la main-d'œuvre collective. Cet exemple montre néanmoins que les œufs brouillés ne sont jamais que des œufs brouillés. Les œufs brouillés peuvent être utilisés pour le petit-déjeuner ou pour être mélangés à un émulsifiant. Ils peuvent être préparés durs ou mous, nature ou salés. En bref, les emplois fournissent un contexte social dans lequel les gens prennent conscience de la façon d'organiser les tâches de manière implicite, ce qui n'est pas facile ou rapide à expliquer en dehors du contexte. Du point de vue de ceux qui diffusent le travail, les plateformes d'intermédiation du travail promettent que les gens peuvent faire exécuter un travail qu'ils ne seraient pas en mesure de faire eux-mêmes. Cela conduit à une augmentation des types de travaux effectués par des étrangers - des travaux effectués pour nous mais par des personnes que nous connaissons peu ou pas du tout ou avec lesquelles nous n'avons pas de contact.
D'une certaine manière, ce n'est pas nouveau - peu d'entre nous savent qui a conduit les camions qui ont livré la nourriture que nous achetons à l'épicerie. Mais ces mécanismes réduisent radicalement la distance entre quelqu'un et cet inconnu. N'importe qui peut demander à un parfait inconnu, par l'intermédiaire d'un système de crowdwork, de créer un site web ou d'organiser un itinéraire de voyage. Cette personne peut n'être connue que par un pseudonyme en ligne, si tant est qu'il soit spécifié. Cela aussi peut modifier la façon dont les gens sont habitués à gérer le flux de connaissances sur le lieu de travail. Cefkin a observé une discussion particulièrement intéressante entre les demandeurs de travail sur la plateforme de crowdwork technique pour le développement de logiciels qu'elle a étudiée. Les travailleurs du système utilisent des noms de compte plutôt que des noms réels.4 Les chefs de projet qui utilisaient la plateforme pour trouver de la main-d'œuvre pour certains de leurs développements techniques se réunissaient chaque semaine pour échanger des conseils et faire le point sur la situation. Lors de la discussion d'une semaine, un responsable a soulevé un problème : les résultats qu'elle avait reçus d'un travailleur de la foule étaient incomplets. Sur la base de son expérience antérieure avec ce travailleur (connu sous son pseudonyme), elle était certaine qu'il s'agissait d'une simple erreur, le travailleur ayant téléchargé le mauvais document. Et lorsqu'elle a communiqué le nom de son compte, d'autres personnes se sont montrées d'accord en se basant sur leurs propres interactions positives avec ce travailleur. Leur discussion s'est transformée en inquiétude lorsqu'elle a indiqué que les messages répétés qu'elle lui adressait par l'intermédiaire du système restaient sans réponse.
Lui est-il arrivé quelque chose ? Serait-il (ils supposent qu'il s'agit d'un "il") malade ? "Comment pourrions-nous savoir s'il a disparu de la surface de la terre ? Aurait-il entre-temps trouvé un emploi à temps plein et quitté la plate-forme ? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait découvrir qui il est (vraiment) et où il vit et prendre de ses nouvelles ? Dans ce cas, les utilisateurs de la plateforme ont rapidement commencé à imaginer un ensemble plus large d'obligations parce que quelqu'un avait commencé à agir d'une manière perçue comme non caractéristique de leurs interactions précédentes sur la plateforme. Ils ont rapidement été freinés dans leurs efforts pour remplir ces obligations en réalisant à quel point le contact uniquement par le biais de la plateforme limitait les interactions en dehors de la plateforme. Les plateformes de distribution de travail en ligne mettent en évidence les questions de qualification et d'adéquation de la formation. Pouvez-vous faire confiance à votre chauffeur Uber ? Pour faire face à cette incertitude, les plateformes fournissent souvent des systèmes de réputation dans lesquels les gens choisissent des travailleurs qui ont été précédemment évalués par d'autres demandeurs de travail. Mais cela signifie qu'il est difficile d'être un nouveau venu dans ce système, et il est, comme l'a souligné Mary Gray, beaucoup plus difficile de passer d'une plateforme à l'autre, car vous ne pouvez pas apporter votre évaluation de réputation avec vous de la même manière que vous pouvez apporter un CV (2015). Aux États-Unis, ces systèmes ont séduit les travailleurs, en partie parce qu'ils offrent la promesse d'une méritocratie.
Les demandeurs d'emploi n'ont souvent aucun moyen de s'assurer de l'origine ethnique, de l'âge ou du sexe d'une personne lorsqu'ils acceptent l'offre de travail. C'est pourquoi des organisations telles que Samasource ont défendu ces plateformes, affirmant qu'elles offrent des opportunités indispensables aux travailleurs à faibles revenus qui sont régulièrement victimes de discrimination lorsqu'ils sont embauchés en personne. Toutefois, les systèmes de réputation peuvent toujours permettre aux gens de pratiquer la discrimination. Une femme afro-américaine interrogée par M. Gershon dans la région de la baie de San Francisco préférait les plateformes où tout le travail restait en ligne à celles qui coordonnaient le travail hors ligne. Elle a expliqué que si les demandeurs de travail la voyaient en personne, ses chances d'obtenir une bonne note dans le système de réputation s'effondraient parce que les demandeurs de travail ne voulaient pas risquer de la voir revenir. Ils n'ont pas pu refuser les travailleurs noirs dès le départ, mais ils ont utilisé le système de réputation des plateformes en ligne pour décourager les travailleurs noirs d'être choisis à l'avenir. Ces systèmes sont également attrayants en raison de la promesse d'autonomie, une autonomie qui est largement absente de la manière dont les emplois organisent les tâches. En d'autres termes, ces systèmes permettent aux gens d'imaginer qu'ils travaillent sans patron, souvent sur des tâches qui impliquent traditionnellement un patron. Au lieu d'un patron, ils ont simplement des clients.
Le fait que les travailleurs choisissent continuellement le travail qu'ils effectuent et peuvent même confier des tâches à d'autres est considéré comme la preuve qu'ils travaillent sur un pied d'égalité avec des individus qui peuvent également choisir des tâches et structurer leur temps selon leurs propres conditions. Il s'agit d'une perception générale, mais les anthropologues du travail savent qu'ils doivent être un peu sceptiques à l'égard de cette affirmation. Le fait qu'une personne consente continuellement à travailler pour d'autres ne signifie pas nécessairement qu'elle dispose de plus d'autonomie ou qu'elle a des relations de travail plus équitables qu'une personne occupant un emploi plus traditionnel. Ni le contrat temporaire (aussi court soit-il), ni l'infrastructure technologique soutenant les appels ouverts ne sont en soi des signes avant-coureurs d'autonomie ou d'équité. Les anthropologues ne savent que trop bien que la liberté ou l'équité ne naissent que de l'organisation sociale qui façonne l'utilisation des technologies et des décisions et actions des participants au fil du temps, lorsqu'ils mettent les contrats en pratique. En maintenant un pied dans ces systèmes, les crowdworkers individuels collaborent souvent étroitement au sein d'un réseau social d'autres crowdworkers pour naviguer et gérer les défis associés à leur travail (Gray et al. 2016 : 134).
Plus précisément, les crowdworkers assument souvent des responsabilités cachées et des risques nés du travail dans un environnement concurrentiel où les tâches lucratives sont rares et où les employeurs peu scrupuleux sont difficiles à identifier par eux-mêmes. De nombreux crowdworkers gagnent souvent moins que le salaire minimum, et ils sont souvent responsables du maintien de l'infrastructure qui les met en contact avec les opportunités de plateformes de travail, comme les véhicules, les ordinateurs, les soins de santé et l'assurance (Ekbia et Nardi 2017 : 60 ; Horton et Chilton 2010). Ils ne doivent pas seulement démontrer une certaine maîtrise de la tâche demandée à un crowdworker ; ils doivent également démontrer une compétence technique avec les technologies et les systèmes qui les connectent avec les entrepreneurs de tâches. Construire une communauté avec d'autres crowdworkers peut donc servir de mécanisme pour apprendre des stratégies et des techniques pour optimiser et permettre leur rôle sur n'importe quelle plateforme de travail donnée. Ces stratégies peuvent cependant changer au fil du temps, car les concepteurs infléchissent souvent leurs propres croyances sur la façon dont les individus devraient se réaliser en tant que serveurs consciencieux, fiables et corrects sur les plateformes de crowdwork. Les crowdworkers d'Amazon Mechanical Turk et d'Uber, par exemple, sont généralement censés adopter des croyances particulières sur l'efficacité économique, l'autonomie individuelle et le consentement contractuel dans leur utilisation des possibilités techniques et des limites de chaque plateforme (Cefkin et Gershon 2018).
Lorsque ces croyances sur le travail sont partagées par les différentes parties de la chaîne d'approvisionnement en main-d'œuvre numérique, les plateformes de distribution de travail transforment pratiquement les travailleurs numériques en une économie numérique computationnelle et en un service de main-d'œuvre qui aide à graisser les roues proverbiales de nombreux exploits modernes d'automatisation puta- tive (Irani 2015). Les crowdworkers assument souvent les tâches et les responsabilités du travail que d'autres souhaiteraient que les ordinateurs puissent faire automatiquement et sans faute, et certains peuvent croire que les tâches de crowdwork représentent simplement le type de travail que les algorithmes logiciels finiront par effectuer sur commande. Envisager le crowdwork et les plateformes de distribution du travail de cette manière, cependant, suppose que le crowdwork est un phénomène temporaire qui disparaîtra inévitablement à mesure que le matériel informatique et les logiciels deviendront de plus en plus "intelligents". Il est peu probable que cela se produise, et ce pour deux raisons. Premièrement, les historiens de la technologie ont depuis longtemps observé que les efforts d'automatisation du travail n'ont jamais tenu leurs promesses de réduire la quantité de travail nécessaire à l'accomplissement d'une tâche ; ce qui se produit le plus souvent, c'est que les personnes autrefois chargées d'un travail sont remplacées, en partie, par une machine qui accomplit une partie du travail requis. Une autre personne ou plusieurs autres sont alors nécessaires pour maintenir et contrôler la qualité du travail effectué par la machine.
Cela signifie que l'automatisation ne rend pas automatiquement les systèmes moins chers et plus efficaces, même si c'est souvent ce qu'elle promet. L'automatisation repousse toujours le travail vers le bas de la chaîne, car les responsabilités de certaines tâches sont fragmentées et réparties entre les doigts délicats de nombreuses mains. À mesure que les tâches manuelles sont de plus en plus microgérées et standardisées, les chaînes d'approvisionnement s'allongent. L'allongement des chaînes d'approvisionnement n'est pas nécessairement mauvais, mais il pose des problèmes différents aux entreprises à la recherche de profits. Ekbia et Nardi observent, par exemple, que Blizzard Entertainment génère des milliards de dollars par an tout en produisant des jeux vidéo avec un effectif de moins de 5 000 personnes ; cependant, la réussite de l'entreprise repose principalement sur l'externalisation de la fabrication du matériel et des logiciels nécessaires pour fabriquer et entretenir les ordinateurs personnels et les consoles de jeu qui exécutent les logiciels créés par Blizzard (2017 : 62). L'entreprise s'appuie également sur l'infrastructure de réseau existante pour soutenir les environnements virtuels en ligne massivement multijoueurs - les systèmes de distribution de matériel qui maintiennent les connexions par câble à fibre optique entre les régions géographiques et les communautés transcontinentales.
Les technologies de plus en plus intelligentes n'éliminent pas le besoin de travailleurs humains ; au contraire, elles créent des conditions matérielles différentes pour la manière dont le travail est effectué, et elles nécessitent des formes d'intervention différentes et nouvelles pour maintenir l'intégrité des tâches automatisées. La médiation du travail par les technologies numériques et les réseaux informatiques ne modifie pas le besoin d'une entreprise pour le type de travail social que les gens effectuent régulièrement à la maison et au bureau ; au contraire, les technologies numériques offrent aux entreprises de nouvelles techniques pour surveiller et codifier la valeur de certaines tâches sociales. Considérer le crowdwork comme un phénomène temporaire, c'est ignorer comment les entreprises et les organisations s'appuient sur les plateformes de distribution du travail pour gagner de l'argent dans une économie mondialisée. Plus précisément, Ekbia et Nardi affirment que les technologies numériques permettent aux personnes et aux entreprises de tirer profit des types de travail qui ne sont généralement pas reconnus dans le monde des affaires : le travail communicatif, le travail cognitif, le travail créatif, le travail émotionnel et le travail d'organisation (2017 : 89). Pour eux, le crowd work et les plateformes de distribution de travail en ligne illustrent la manière dont la logique d'inclusion, l'engagement actif et le contrôle invisible fonctionnent dans la façon dont le travail humain est géré 234 Iris Bull et Ilana Gershon (Ekbia et Nardi 2017 : 39). Ces attributs du travail numérique en ligne contribuent à définir une nouvelle approche de l'extraction de la valeur économique de la main-d'œuvre bon marché ou gratuite : l'hétéromation.
Les plateformes de distribution du travail en ligne normalisent la manière dont les personnes orchestrent les tâches à l'échelle mondiale pour les entreprises et les organisations qui dépendent d'une main-d'œuvre hétérogène. Elles permettent aux entreprises et aux organisations d'accomplir d'incroyables prouesses en matière de traitement humain et de calcul, tout en caractérisant un nouveau domaine d'exploitation des travailleurs. Pour conclure cet aperçu des sujets pertinents pour l'étude du travail numérique, il est utile de revenir à l'imagination populaire des futurs environnements de travail. Les visions dystopiques des sociétés avancées sur le plan informatique ont tendance à mettre l'accent sur la manière dont les gens utilisent les technologies numériques pour subjuguer et exploiter les vulnérabilités et les inégalités des individus ou pour automatiser le travail humain jusqu'à ce qu'il n'existe plus. Les visions utopiques, en revanche, représentent souvent les technologies numériques comme des outils de libération personnelle et communautaire. Cependant, les anthropologues ont également le devoir d'enquêter sur ce que les récits populaires omettent souvent au sujet du travail médiatisé par les ordinateurs. Qu'est-ce qui rend le travail numérique possible ? Qui bénéficie de ces conditions de travail, et comment en bénéficient-ils ? Qui est lésé par les conditions matérielles du travail numérique, et comment ? Et enfin, qui est pénalisé lorsque ces systèmes technologiques tombent en panne ou ne fonctionnent pas comme prévu ?