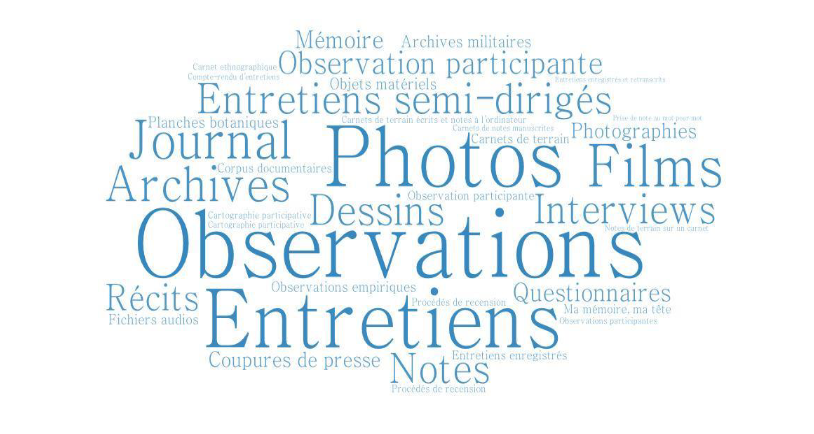Je suis une historienne des personnes. Parfois, j'essaie de comprendre les gens en observant leurs espaces ou leurs matérialités, ou en disséquant leurs idées, leurs habitats ou leur contexte. Mais en définitive, je m'intéresse à ce que les gens pensent et font (ou ne font pas) et pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent et font ce qu'ils font (ou ne font pas). J'ai essayé d'être un historien différent - de me concentrer sur les structures, de me laisser guider par la théorie, ou d'écrire les grandes histoires qui se vendent bien en librairie. Pourtant, je m'intéresse trop aux détails des personnes - à leurs subjectivités et à leurs identités - pour exceller dans les histoires qui n'ont pas le nez sur le sol. J'aime penser à mes sujets de manière si intense que je peux ressentir leurs espoirs et leurs douleurs. Parfois, ils vivent avec moi d'une manière plus réelle que les personnes qui font physiquement partie de ma vie. Cet essai est une tentative d'encadrer ces sentiments très peu professionnels en un argument plus pratique et professionnel. Il s'agit d'une tentative de donner un sens à l'enchevêtrement de mon "moi d'auteur" dans le processus de recherche et d'écriture des subjectivités de mes protagonistes.
J'ai commencé à faire des recherches sur les hippies soviétiques en 2008 dans le cadre d'un projet portant sur les réseaux d'activistes autour de 1968.1 En 2021, après 135 entretiens réalisés dans l'espace post-soviétique, aux États-Unis, en Israël, en Allemagne et en France, mon livre Flowers through Concrete : Explorations in Soviet Hippieland est sorti. Outre les entretiens, il contenait les traces de nombreuses visites d'archives, de nombreuses heures à la bibliothèque et d'un temps considérable passé à surfer sur le web. Pourtant, bien avant que je ne fasse quoi que ce soit de mon sujet, il a de plus en plus façonné ce que j'étais. J'ai passé beaucoup de temps avec mon sujet. Tout le temps qui n'était pas occupé par mes enfants. Mon sujet, comme c'est souvent le cas, est devenu mon identifiant et mon identité lors d'ateliers, de conférences et sur mon lieu de travail. Mais il est également vrai qu'au fil du temps, mon sujet est devenu de plus en plus ce que moi, Juliane Fürst, émigrée allemande en Angleterre, spécialisée dans l'histoire et la jeunesse soviétiques, j'en ai fait. L'histoire des hippies soviétiques s'est formée à travers mes mots et s'est réfractée à travers mes opinions et mon identité. Contrairement à certains chroniqueurs de la sous-culture des jeunes, je n'ai jamais été membre de "la tribu", et je n'ai jamais partagé l'âge ou la nationalité de mes sujets. Pourtant, j'ai très vite pris conscience que la frontière entre mes sujets et moi, entre leurs informations et le traitement que j'en faisais, était étrangement floue - en tout cas beaucoup plus floue que ce que ma formation historique avait établi comme norme d'excellence pour écrire l'histoire. La subjectivité m'entourait désespérément. Elle était partout où je me tournais, y compris et surtout en moi-même. Et c'était plutôt amusant. Ma formation historique m'avait appris à éradiquer, ou du moins à atténuer, la subjectivité, mais j'aimais bien son existence joyeuse. Je voulais trouver un moyen de lui donner un sens, pas de la tuer. Je voulais la rendre utile plutôt que distrayante. Je voulais montrer clairement que les préjugés faisaient partie intégrante de mon travail et qu'ils étaient en fait mes amis plutôt que mes ennemis dans le processus d'écriture.
2.2 Le soi de l'auteur
Les historiens de facto conviennent depuis longtemps que l'objectivité n'existe pas - les philosophes français des années 1960 l'ont supprimée. Mais ils n'ont donné aucune indication sur ce par quoi elle pourrait être remplacée. La réponse évidente est que si nous ne pouvons pas avoir d'objectivité, parce qu'il s'agit d'une utopie inaccessible, alors il nous reste une forme de subjectivité. C'est mon travail d'historien oral (le projet de 1968 était explicitement conceptualisé comme une enquête basée sur des entretiens) qui m'a ouvert les yeux sur le gouffre entre ce que nous prêchons et ce que nous pratiquons. L'histoire orale suscite encore parfois d'étranges réactions de la part des critiques et des rédacteurs de revues, ce qui oblige les historiens oraux à se livrer à une étrange danse rituelle au début de leurs livres et de leurs articles, dans lesquels ils critiquent leur méthodologie jusqu'à l'anéantir, avant de procéder à l'une des deux choses suivantes : ils ignorent toutes leurs réticences et utilisent des preuves issues d'entretiens comme si aucune subjectivité n'était impliquée, ou ils finissent par discuter de la subjectivité de leurs sources au point d'écrire une histoire des entretiens plutôt que l'histoire que leurs interlocuteurs leur racontent. Ces deux stratégies ont énormément contribué à l'élargissement des possibilités de l'histoire : la première parce qu'elle a mis en lumière des domaines de l'histoire qui n'étaient guère reflétés dans les archives et qui étaient donc jusqu'alors sous-représentés.2 La seconde parce qu'elle a souligné l'importance de l'ici et du maintenant pour la mémoire historique et la complexité des identités individuelles changeantes dans un cadre de mémoire collective.3 Pourtant, très peu de travaux ont tenté de faire dialoguer ces deux lignes d'enquête. Encore moins nombreux sont ceux qui reconnaissent que l'intermédiaire entre les deux est l'auteur et sa subjectivité. Pendant un certain temps, j'ai adopté une ligne de conduite bolshie lors de la présentation de mon projet, affirmant avec défi que j'interviewais des hippies soviétiques uniquement pour les informations historiques qu'ils pouvaient me fournir. J'admettais que je me rendais compte que ces informations étaient déformées par leur subjectivité et la mienne, mais qu'une information compromise valait mieux que l'absence d'information, ce qui, dans le cas des hippies soviétiques, était l'alternative aux entretiens. Dans le même temps, je divertissais mes amis et mes collègues en leur racontant comment j'avais voyagé à travers le monde à la recherche d'anciens hippies soviétiques, à quel point certaines de mes situations d'entretien étaient aventureuses ou bizarres, et à quel point il était difficile de donner un sens à ce matériel d'entretien amorphe et à toutes les observations que j'avais sur le lieu, la nature et l'esprit des entretiens dans un seul texte universitaire. J'étais bien conscient de la nature schizophrénique de mon utilisation de mes sources : Je pratiquais une séparation presque totale entre le personnel et l'académique - et entre l'émotionnel et l'intellectuel. Pendant un certain temps, j'ai eu l'idée de produire un livre de voyage et d'histoire pour le marché commercial, mais j'ai perdu confiance. J'ai fini par écrire un livre académique plus standard avec un soupçon d'auto-réflexion personnelle, mais en évitant de mettre pleinement en œuvre ce que, en l'absence d'un bon paradigme établi, j'appellerai la "transparence radicale" - une véritable analyse de ce qui se passe lorsqu'un historien filtre un sujet à travers ses propres subjectivités afin de produire un récit historique. Le terme - dérivé de l'expression "empirisme radical" utilisée en 1989 par Michael Jackson - et les idées qui le sous-tendent s'appuient fortement sur la longue série de travaux réalisés par des ethnographes et des anthropologues qui ont été beaucoup plus conscients de l'implication de leur "moi" dans leur travail (voir par exemple Davies et Spencer 2010).
Il n'existe pas encore de terme approprié pour décrire l'écriture de l'histoire qui accorde un poids égal aux subjectivités du sujet et de l'auteur. Cependant, plusieurs historiens ont franchi le fossé entre le personnel et l'académique au fil des ans (sans parler des innombrables anthropologues qui ont reconnu l'interférence du soi bien plus tôt, voir par exemple Rabinow (1977), Visweswaran (1994, 95-113), Geertz (1988), Clifford et Marcus (1986) et Starn (2015)). Il y a également eu des tentatives de conceptualiser l'acte d'écrire, en particulier l'écriture du traumatisme, comme une "voix intermédiaire", un interlocuteur de la victime au monde extérieur. Cependant, plutôt que de privilégier la subjectivité de l'auteur, cette approche la marginalise en faveur de la voix de la source primaire, dont le caractère sacré ne peut être touché par la corruption de l'auteur. Dominick LaCapra est donc très critique à l'égard d'une telle postulation sur la voix de l'auteur, qu'il considère comme laissant de côté le "souci de l'empathie" - une émotion qui souligne mais aussi interprète l'expérience de la victime et concède ainsi un rôle à l'auteur (LaCapra 2001).
Par rapport à il y a une ou deux décennies - ou même à l'époque où j'écrivais mes premiers essais d'histoire à l'université, dans les années 1990 - le "je" est devenu un chiffre beaucoup plus accepté qu'auparavant dans les textes historiques. Carolyn Steedman a été une pionnière dans ce domaine, lorsque dans son Landscape for a Good Woman (1986), elle a brisé les frontières entre source et auteur en utilisant ses souvenirs pour commenter les paradigmes historiques, tout en se servant de sa formation en histoire pour donner un sens à sa vie et à celle de sa mère. Dans le domaine de l'histoire de l'Europe de l'Est, Kate Brown (2004, 2020) a activement pratiqué et fait campagne pour l'inclusion de la première personne dans le récit, reflétant sa présence constante dans le processus de recherche. L'avènement des blogs dans la sphère historique a donné à la voix de l'auteur un poids différent. Des historiens tels que Matt Houlbrook ont utilisé leur blog pour surmonter des blocages d'écriture ou des moments méthodologiquement difficiles, déclarant que "Être ouvert aux luttes que les historiens préfèrent souvent garder privées est ma façon de démystifier ce que nous faisons. J'espère que cela pourra également lancer une conversation continue sur la façon dont l'histoire est travaillée et écrite".4 L'appel le plus franc et le plus cohérent pour l'inclusion du "je" a été exprimé dans des travaux récents liés à la "décolonisation" de l'histoire et au recentrage de l'attention sur les agents historiques blancs. Robin Mitchell (2021), historienne des femmes noires en France au dix-neuvième siècle, a affirmé que : "Je suis une femme noire qui écrit sur les femmes noires dans l'histoire européenne. Je m'emmène avec moi partout où je vais". Il n'est pas surprenant que, dans le sillage de Black Lives Matter et dans un monde où l'identité personnelle fait l'objet d'une attention sans précédent, les facteurs qui font de nous "nous" soient pertinents pour et dans le travail que nous faisons. Il semble étrangement décalé par rapport au discours public général de réfléchir si intensément à ce que nous sommes, à la manière dont nous sommes décrits et à la façon dont cette description façonne la société et s'y reflète, sans pour autant appliquer ces considérations à l'une des professions les plus importantes pour façonner le discours public : l'écriture de l'histoire. "Je n'ai aucune envie d'écrire ou de lire une histoire qui suppose que ma rage, ma tristesse et mes autres émotions n'ont pas leur place dans la discipline ou dans l'écriture. Elles en ont une", écrit Robin Mitchell (2021) avec défi. Elle a raison d'anticiper un repli sur l'idée d'émotions et d'affects d'auteur. En effet, il faut aller jusqu'au rejet total du "saint graal" de l'histoire - l'objectivité et l'impartialité - pour faire de la place aux émotions, à l'identité et à l'histoire personnelle de l'auteur - bref, au "moi auteur".
Le débat sur le "tournant racial" commence à influencer les études d'Europe de l'Est, comme en témoigne la dernière édition de la Slavic Review, dans laquelle l'identité personnelle des sujets et des chercheurs fait l'objet d'une attention égale. À juste titre, l'attention portée au rôle de la "race" dans les études slaves n'est pas seulement une question de savoir qui et quoi nous étudions, mais aussi qui fait l'étude. Et comme le souligne l'un des contributeurs à ce numéro, Maria Mogilner (2021, 208), cela pourrait également s'étendre à la manière dont nous étudions l'histoire : "J'espère, ...., que la découverte de la "race" comme catégorie d'analyse utile s'accompagnera d'une critique épistémologique approfondie et d'une déconstruction des canons et paradigmes existants". Si, dans ce cas précis, Mogilner pensait davantage à la redéfinition de l'empire et du colonial en tant que paradigmes, je soutiens que cette déconstruction doit également inclure une prise de conscience que le processus de "faire l'histoire" inclut l'identité de l'historien. La "race" n'a été que le plus important d'une variété de marqueurs d'identité qui ont forcé l'académie historique à repenser ses paradigmes, ses hiérarchies et ses subjectivités (je m'abstiens délibérément d'utiliser le terme "partialité" en raison de ses connotations négatives). La "décolonisation" a mis à nu un certain nombre de relations coloniales et postcoloniales au sein de l'Europe de l'Est et avec elle, allant de l'attention portée aux vies et aux identités des nations, ethnies et cultures non blanches aux interactions complexes (parfois qualifiées de postcoloniales) entre les historiens occidentaux et orientaux dans le monde post-socialiste. Plusieurs chercheurs ont attiré l'attention, à juste titre, sur le fait que la racialisation historique de l'Europe de l'Est (comme l'a fait de manière évidente, mais pas exclusivement, l'idéologie nazie) complique l'image de la "blancheur" en Europe (West Ohueri 2021 ; Drews-Sylla et Makarska 2015). La question de savoir qui écrit l'histoire de qui et avec quel droit et quel effet fait soudain partie intégrante du débat historique. Il est évident que cette question ne peut être résolue que par une bonne et sérieuse introspection de l'auteur. En bref : nous vivons dans un monde où nous ne pouvons plus ignorer le moi de nos historiens. Cela est vrai pour les historiens d'Europe de l'Est autant que pour les autres.
Les historiens d'Europe de l'Est sont les produits d'une évolution historique, qui ont été façonnés par des événements historiques au cours de leur vie - et il est très probable que ces événements se sont déroulés dans la région même que nous étudions. Il y a quelques années, plusieurs messages ont été publiés sur les médias sociaux, par exemple, sur la mesure dans laquelle Tchernobyl a façonné ma génération d'historiens. Bien que l'accent ait été mis sur ceux qui ont vécu la catastrophe en tant qu'enfants dans la région, je peux certainement dire que la chute tout à fait littérale de Tchernobyl (sous forme de pluie radioactive) dans la Bavière non socialiste a également laissé une césure importante dans ma vie. Avec le recul, c'est peut-être l'événement de ma génération. Nous sommes également de plus en plus conscients que ce n'est pas seulement notre propre vie, mais aussi celle des personnes dont nous sommes les plus proches qui façonnent notre psyché et donc notre conscience historique. Les traumatismes de notre famille immédiate ont longtemps eu l'odeur de moisi des recherches généalogiques effectuées par notre grand-tante. Pourtant, les sciences naturelles et sociales ont révélé qu'il s'agit de récits transférables qui ont une grande influence sur la perception que les gens ont d'eux-mêmes et du monde (voir par exemple Schwab 2010 ; Huber et Plassmann 2012). Nous sommes des humains qui aiment, pleurent, se battent, souffrent et sont joyeux, tout en faisant des recherches et en écrivant l'histoire. Et parfois, l'histoire nous aide à donner un sens à nos vies personnelles. Dans un récit personnel et sans complaisance de ses années d'études supérieures à Berkeley, Joy Neumeyer (2021) a récemment révélé comment sa formation d'historienne l'a aidée à démêler les récits contradictoires qui façonnaient sa propre vie de victime de violence domestique et à retrouver confiance dans les faits qu'elle savait vrais. Son article impressionnant nous rappelle également que si nous nous identifions souvent à des personnages historiques qui partagent nos identités principales, nous nous connectons par le biais d'une grande variété de marqueurs, dont certains ne deviennent apparents qu'au cours de la recherche ou de l'enseignement. Ainsi, Nikolaï Boukharine est devenu la voix du passé qui rappelle à Neumeyer la futilité de suivre les récits des autres.
2.3 Le moi auteur
Mon histoire personnelle (ou plutôt l'absence d'une histoire personnelle évidente qui pourrait me relier à mes sujets ou à la région qui m'intéresse) m'a obligé à réfléchir à mon rôle dans le domaine de l'Europe de l'Est et de l'Union soviétique. Lorsque j'ai écrit mon premier livre - une histoire de la jeunesse sous le stalinisme tardif - je me suis rarement posé la question de la légitimité de mon projet. J'avais les yeux rivés sur mes sources d'archives et sur la nécessité de construire une carrière universitaire. C'est le luxe d'un emploi stable, mais aussi la forte identité de groupe des sujets de mon deuxième livre, les hippies soviétiques, qui m'ont amené à me demander pourquoi je faisais ce que je faisais et quelles étaient mes justifications. Dès le début de mes recherches sur la culture des jeunes, j'étais conscient que la plupart des personnes qui étudiaient la sous-culture étaient profondément impliquées dans la "sous-culture" et faisaient surtout partie de la "sous-culture". Je n'étais pas hippie et ne l'avais jamais été (même si, au cours de mes recherches, j'ai découvert que je possédais des bribes de l'âme hippie). Avec la parution du livre d'Alexei Yurchak sur la dernière génération soviétique, le socialisme tardif en tant que tel s'est imposé comme une sorte de communauté d'initiés dont les rituels, les gestes et le langage complexes et souvent ironiques étaient mieux décodés par les initiés. Cela a mis en lumière ce qui était un éléphant dans la salle des études slaves depuis de nombreuses années : dans quelle mesure les historiens non natifs pouvaient-ils écrire l'histoire soviétique/post-soviétique, étant donné qu'aucune étude ne pouvait remplacer les connaissances acquises par l'éducation et la socialisation ? J'ai certainement ressenti, de manière aiguë, les deux distances - celle entre mon moi non sous-culturel et mes sujets hippies radicalement non-conformistes et celle entre moi en tant qu'Occidental (je ne peux même pas prétendre à des références est-allemandes) et mes interlocuteurs post-socialistes. Cela m'a fait réfléchir longuement à ce que je pouvais apporter à mon sujet et à la façon dont je pouvais transformer mes "déficiences" - y compris ma subjectivité occidentale et bourgeoise - en éléments de construction plutôt qu'en obstacles.
Ironiquement, j'ai trouvé l'inspiration dans cette entreprise dans les mêmes théories post-coloniales qui m'ont fait remettre en question ma place dans l'académie d'Europe de l'Est en premier lieu. J'étais un outsider - et doublement pour mes sujets hippies subculturels. J'étais un universitaire occidental avec une formation occidentale. J'ai dû apprendre les codes soviétiques (et ce serait faire preuve d'orgueil que d'insinuer que cet apprentissage a jamais atteint la compétence d'un natif) et, en plus, j'ai dû apprendre les codes hippies (pour lesquels la même chose s'applique). Pourtant, bien que très consciente de mes défauts, je croyais aussi instinctivement que je pouvais apporter quelque chose au projet, moi, la non-soviétique et la non-hippie. Les études postcoloniales et de traduction ont mis en évidence le fait que le "natif" n'est pas nécessairement le seul ni même le meilleur vecteur pour établir une identité (Chow 2014). En effet, les "natifs" ont besoin des "non-natifs" pour établir leur crédibilité normative. Ce n'est qu'avec le son d'un accent que l'on peut définir la norme - qui, bien sûr, n'émerge que comme un autre accent. J'étais indubitablement et à tous les niveaux la personne à l'accent. Je parlais avec un accent, je ressemblais à la personne avec un accent et j'écoutais avec un accent.
Dès le début, je savais que ces faits étaient à la fois utiles et difficiles. Le fait que je ne sois pas un initié par la géographie suscitait généralement plus de curiosité que d'aversion. Le fait que je n'appartenais pas à la bande des hippies ou à une autre partie de l'underground soviétique mettait ironiquement les gens plus à l'aise. Premièrement, ma présence permettait aux anciens hippies de regarder leur histoire comme ils supposaient que je le faisais - en tant qu'étranger sans idée préconçue - et leur permettait donc de reconsidérer même les principes de base de leur histoire ou de révéler des souvenirs qui n'étaient pas considérés comme faisant partie du canon accepté. Deuxièmement, je remplissais une fonction interne compliquée au sein de la communauté hippie, que je pouvais toutefois utiliser à mon avantage pour décoder les messages cachés. Il y avait des hiérarchies et des couches au sein de la foule hippie, qui ne sont pas moins complexes que celles de la bureaucratie soviétique officielle. Ces hiérarchies et couches de statut social sont basées sur un système complexe de pondération de la date et de la durée du "service" hippie, des réalisations dans des domaines acceptés par les hippies tels que la chanson, la poésie et l'art, et de la réputation locale et nationale. J'étais considéré comme une toile sur laquelle on pouvait projeter des souvenirs, qui servaient à leur tour à cimenter ou à réaligner ces hiérarchies et ces couches. En bref, moi, l'étranger, j'étais instrumentalisé de plusieurs façons, dont très peu auraient été conscientes, mais qui toutes s'appuyaient sur les qualités mêmes de mon statut d'étranger. Et toutes ont contribué à mon objectif premier de collecte d'informations, et non à son contraire. Lorsque, après une décennie d'entretiens avec d'anciens hippies, je me suis tourné vers les transcriptions de mes premières conversations, j'ai été surpris de constater qu'en termes d'informations, elles n'étaient pas moins bonnes, et même souvent supérieures à celles de mes entretiens ultérieurs, lorsque j'avais échangé mon innocence initiale contre des connaissances d'initié. Mon style avait évolué vers des questions plus précises, mais aussi plus orientées. Mon esprit s'était détourné d'une ouverture totale pour s'intéresser à certaines histoires et biographies. Les deux ont leurs mérites. Mais les premières transcriptions - avec toutes leurs questions naïves et leurs moments de confusion évidents - m'ont rappelé avec force que, paradoxalement, la différence peut engendrer la familiarité. J'étais à bien des égards le proverbial étranger qui est le catalyseur révélant l'histoire. Et rien ne confirmait davantage mon statut d'"étranger" que mon "accent" - ou, comme l'avait appelé un jour mon professeur de phonétique russe - mes "défauts".
Ce qui était peut-être encore plus intéressant que "parler et regarder avec un accent" était "écouter avec un accent". Sans aucun doute, la frontière est mince entre "écouter avec un accent" et "mal comprendre les choses" (et où se situe cette frontière, c'est sujet à débat). Je vais illustrer ce que j'entends par "écouter avec un accent" en racontant l'histoire d'une interview particulière. Plusieurs personnes m'avaient indiqué une femme hippie de Moscou qui s'intéressait elle-même à l'histoire des hippies. Ses références hippies (je n'ai jamais demandé de "références", mais dans ce cas, c'est devenu un trope dominant dans l'interview) provenaient de son mari, qu'elle présentait comme une voix importante de la communauté hippie de la fin des années 1970 et des années 1980. Leur cour et leur mariage ont correspondu à son ascension d'une jeune fille indisciplinée et mélomane à un hippie du sistema de Moscou, le réseau informel de hippies dans toute l'Union soviétique. Sa mort soudaine après neuf ans de mariage a été la grande rupture de sa vie et a déclenché une descente dans l'alcool, qu'elle a surmontée, trouvant une nouvelle vie dans le monde post-socialiste en tant que traductrice, réussissant ainsi une meilleure transition dans le monde capitaliste que beaucoup d'autres. Elle a prononcé plusieurs phrases intéressantes à propos de sa relation avec son mari, qu'elle adorait et aimait malgré sa santé mentale fragile, ses fréquentes automutilations et sa toxicomanie. Mais il y avait aussi un côté un peu rebelle dans son récit - du moins c'est ce que j'ai entendu. Elle m'a dit qu'il l'a demandé en mariage avec les mots : "Maintenant tu n'es personne, mais si tu m'épouses, tu seras la femme de X" (Fürst 2021, 407). L'impression qu'il y avait un soupçon de ressentiment à l'égard de sa domination présumée a été renforcée par son récit selon lequel il l'a obligée à retourner à l'université pour obtenir un diplôme de philologie parce qu'il avait honte d'avoir une femme scientifique (montrant ainsi tous les préjugés de l'intelligentsia soviétique classique). Mon correspondant a demandé une transcription de l'interview, que j'ai fournie et qui a été approuvée après quelques corrections mineures, mais aucune qui concernait les remarques sur son mari.
J'ai pris la liberté d'interpréter son interview dans mon livre comme ce que j'ai entendu à l'époque : une épine légère, mais perceptible, dans sa chair, qui était en contradiction avec la forte vénération qu'elle affichait par ailleurs envers la mémoire de son mari. En bref, une protestation contre son traitement en tant que femme. J'ai cru entendre une lueur d'indignation à l'idée qu'il s'arrogeait le droit d'avoir des opinions sur son importance et son éducation. Et j'ai pris ce soupçon d'indignation et je l'ai mis au centre de la scène, car à mon oreille, il a hurlé comme une sirène. J'avais le privilège d'avoir un retour collectif de mes sujets après la publication via un groupe Facebook spécialement créé. Lorsque le groupe a atteint le chapitre concerné, mon interviewée est devenue très anxieuse et a affirmé que ses remarques avaient été "stiob" - un détachement ironique de ce qui a été dit - et ne devaient pas être lues comme une critique de son mari. Si sa protestation était probablement fondée dans une large mesure sur la dynamique de groupe de ce groupe Facebook, une partie de celle-ci était sans doute aussi le résultat de ma propre écoute subjective de son témoignage. Mais je conteste qu'il ne s'agisse pas d'une écoute "correcte" ou "incorrecte". Notre réception a plutôt été conditionnée par nos différents contextes, qui sont tous deux finalement révélateurs de l'histoire dans son ensemble.
Mon interlocuteur a entendu ses paroles comme elles auraient été comprises dans le monde soviétique - comme une anecdote dont il fallait rire plutôt que de la disséquer pour en dégager la signification sociétale. Bien sûr, avoir un diplôme de la faculté de philosophie était d'un ordre plus élevé qu'un diplôme d'ingénieur et, bien sûr, les alliances romantiques faisaient des "gens", surtout si le créateur en question avait un pedigree soviétique très distingué en tant que descendant d'une grande famille militaire. J'avais été élevée en entendant le sous-texte insultant du badinage masculin. J'ai entendu l'insulte dans son histoire. Et de l'indignation dans sa description. Je pouvais l'entendre réclamer son agence après avoir fait ce qu'il lui demandait. Alors, ai-je eu tort d'entendre ces choses ? Après tout, mon interlocutrice a pris ses distances par rapport à mon interprétation. Ou avais-je raison, parce que j'ai entendu exactement ce qu'elle voulait que j'entende, mais ne pouvait même pas admettre à elle-même que c'était ce qu'elle voulait dire ? Après tout, elle m'a offert les mots de son mari, qu'il est difficile de ne pas interpréter au moins comme des déclarations ambiguës. Il n'y a pas de réponse définitive à ces questions. Mais il y a sans doute un plus large éventail d'interprétations possibles, car j'écoutais "avec un accent". Mon "défaut" a amplifié ce qui, autrement, aurait pu être entendu. Depuis lors, d'autres femmes m'ont écrit pour exprimer leurs propres ambivalences à l'égard de leurs illustres maris hippies en des termes plus clairs et plus forts que la citation originale. Et tout cela a été possible, parce que mon oreille n'était pas en phase avec celle de mes sujets.
La vérité est, bien sûr, que nous "écoutons avec un accent" nos interlocuteurs, mais nous "lisons avec un accent" et "écrivons avec un accent" également. La plupart des questions historiques se posent lorsque nous sommes assis à notre bureau plutôt que lorsque nous recueillons nos preuves. Ou, peut-être plus exactement, notre subjectivité entre en jeu un certain nombre de fois dans le processus de "production" de l'histoire. Ou, comme l'affirme Hayden White (1987), l'histoire dépend du récit que nous avons choisi. Certaines de nos interventions historiques les plus importantes ont lieu lorsque nous décidons comment raconter une histoire. Cette décision fait incontestablement partie de notre subjectivité, mais elle est rarement rendue transparente en tant que telle. Lorsque j'ai écrit l'histoire des hippies soviétiques, j'avais deux grands thèmes dont je savais que je pouvais les raconter selon deux modes de narration très différents sans être infidèle aux sources dont je disposais : l'un concernait le séjour des hippies dans les hôpitaux psychiatriques, l'autre le rôle des femmes au sein du mouvement. Dans les deux cas, les témoignages recueillis lors d'interviews et dans d'autres médias ont permis une représentation positive. Les hippies ont réussi à subvertir le trope de la folie qui leur était imposé par les autorités soviétiques et l'ont utilisé à leur avantage pour échapper à la conscription et s'offrir un espace d'irresponsabilité ; les filles hippies étaient éminentes au sein de la communauté et participaient au mouvement sur un pied d'égalité. Ou bien une image négative - les hippies ont finalement été écrasés par le régime brutal et avilissant des institutions psychiatriques, les femmes hippies ont été pour la plupart effacées de la mémoire collective hippie et soumises aux mêmes pratiques misogynes que les autres femmes soviétiques dans une société qui valorise les masculinités machistes (Fürst 2021, 378-432). Il y avait des preuves pour soutenir presque toutes les positions sur l'échelle entre le positif et le négatif. Que fallait-il faire ?
Ce qui a été fait, c'est que j'ai fait un choix. J'ai décidé de défendre la position moins évidente de l'autonomisation des hippies par la folie. J'ai fait allusion aux ambiguïtés de la description de la psychiatrie en mettant les deux interprétations sur la table - et en terminant le chapitre par la plus pessimiste, celle des hippies contraints à la soumission. J'ai cité toutes les preuves dont je disposais sur le durdom - la maison de fous en argot russe : les provocateurs, les laids, les conciliants et les effrontés. Il n'était pas nécessaire d'imaginer que ces derniers - se vanter d'avoir trompé le médecin ou d'avoir subverti le régime - étaient un récit de survie. Mais en tant qu'historien, je connaissais la signification très réelle de la construction de la mémoire : la mémoire détermine la conscience dans une mesure au moins égale. Dans un environnement qui reposait tellement sur la contestation de la signification (qui est normal ? Qui est fou ? Qui gagne une bataille de volontés où les règles sont redéfinies chaque jour ?), les dissidents luttaient contre le fait d'être déclarés fous (même s'ils connaissaient aussi le trope consistant à se dire anormaux, parce que les gens "sains d'esprit" étaient vraiment fous). Les hippies ont mené un combat différent. Ils ont déplacé le terrain sur lequel la bataille était menée en embrassant la folie comme un trait de caractère, un honneur et une tactique. Mais ils ont aussi souffert. Ils ont été humiliés, dépouillés de leur dignité et souvent même de leur humanité. Pourquoi ai-je insisté sur le premier point et non sur le second ? Il est clair qu'il y avait plus en jeu ici que le simple énoncé de faits. Il s'agissait en définitive d'un jugement de valeur et je l'ai fait pour mes propres raisons conscientes, inconscientes et semi-conscientes.
Voici ce qui, j'imagine, a déterminé ma subjectivité : Pour une fois que j'avais le choix entre écrire un argument de "victimisation" ou de "résilience", j'ai choisi la "résilience", parce qu'elle me semblait être l'histoire la plus importante et la plus inhabituelle lorsqu'on écrit sur les répressions soviétiques. Toutes les victimités se ressemblent un peu, mais toutes les résistances sont subtilement différentes. Je suis historien de profession et anticonformiste de nature. Bien sûr, je me suis accroché au récit le plus provocateur. Je voulais montrer que les hippies n'étaient pas seulement les parents pauvres des dissidents qui avaient longtemps revendiqué le récit d'un emprisonnement psychiatrique injuste comme propre à leur expérience. L'étude de la résilience m'a permis d'avancer un argument non seulement sur les hippies mais aussi sur la psychiatrie soviétique. Deuxièmement, il était plus agréable de raconter une histoire où le perdant gagne, du moins un peu. Le fait que mes recherches m'aient fait sympathiser avec mes sujets était un fil rouge constant dans mon auto-évaluation. Bien sûr, je voulais que les hippies représentent plus qu'un triste épisode de l'histoire soviétique, écrasé par un régime beaucoup plus grand et puissant qu'eux. En effet, ma thèse de travail était qu'il n'y avait pas de frontière claire entre le régime, la société et les hippies. J'étais conscient qu'il était difficile de défendre l'idée d'un organisme pour des personnes qui étaient à la merci des médecins et soumises à des médicaments qui pouvaient les réduire à un espace végétatif. Et cela m'encourageait encore plus à ne pas souscrire à la dichotomie victime/agresseur.
Lorsque mes lecteurs hippies sont arrivés au chapitre sur la psychiatrie, j'étais assez nerveux. J'avais peur qu'ils réagissent mal au fait que je mentionne tout de même certaines des expériences dégradantes qu'ils ont vécues dans cet environnement. Les premiers messages portaient en effet sur "la façon dont ils avaient trompé le système". Puis le ton a changé. Sans entrer dans les détails, on admettait de plus en plus que "nous ne parlons pas vraiment de la gravité de la situation". Ces mots étaient prononcés par des partisans par ailleurs fidèles à l'ambiance optimiste des souvenirs hippies. J'ai commencé à me demander si je n'avais pas été trop influencé par mes propres objectifs dans mon interprétation. N'avais-je pas omis d'obtenir plus de détails parce que la déshumanisation qui se produit dans l'hôpital psychiatrique ne mettait pas seulement mes interlocuteurs mal à l'aise, mais aussi moi-même ? Un récent court séjour à l'hôpital pour une opération m'a rappelé à quel point je déteste être malade et être à la merci d'étrangers, même s'ils sont là pour m'aider. Est-ce ma propre horreur de ce qu'impliquerait l'enfermement dans une institution psychiatrique qui a inspiré mon récit ? Un récit qui s'est imposé facilement puisqu'il correspondait à celui de nombreux hippies ? Sans regretter d'avoir mis l'accent sur la capacité d'agir des hippies, même dans une situation classique de répression, j'aurais aimé faire face à la projection possible de ma propre terreur sur les récits de mes interlocuteurs. Pour être précis, j'aurais souhaité être plus subjectif plutôt que moins. J'aurais voulu confronter mon propre malaise face à l'impuissance et à l'intervention corporelle, et donc peut-être encourager mes interlocuteurs à explorer le leur.
Le deuxième grand choix auquel j'ai été confrontée concernait le féminisme. Ici, je n'ai pas manqué de conscience de mes propres motivations et je ne me suis pas fait d'illusions sur le fossé qui me sépare de mes sujets, y compris mes sujets féminins. Les femmes, le genre, le féminisme sont parmi les sujets les plus glissants que l'on puisse étudier dans le contexte soviétique, car pratiquement chaque terme, chaque concept et chaque action doit être évalué différemment dans le contexte soviétique que dans le contexte occidental. L'histoire soviétique de l'émancipation est parsemée de paradoxes, présentant de véritables réussites à côté d'exemples effroyables de misogynie. L'émancipation était un projet d'État - un fait qui l'a empêché de gagner un terrain substantiel dans la contre-culture. J'ai parlé avec toutes les personnes que j'ai interrogées du rôle des femmes hippies - et avec certaines d'entre elles, du féminisme de manière explicite. À une exception près, personne ne voulait être associé au mot en F (dans les années 1990, le féminisme à l'occidentale a été honni par les Russes, y compris par la plupart des femmes russes), alors que moi-même, après avoir cru pendant des décennies que le féminisme appartenait au passé, je me suis déclarée féministe. Comment faire tenir ce nœud intangible de différences et de subjectivités souvent mutuellement exclusives sur une page, et encore moins sur un récit final et historique ? Toute ligne d'argumentation que je pouvais décider trahissait mes convictions ou celles de mes sujets. L'attractivité féminine était-elle sans importance ou une arme de pouvoir importante ? L'amour libre était-il une libération sexuelle pour les hommes et les femmes ou permettait-il d'obtenir des faveurs sexuelles ? La vie hippie était-elle égale parce qu'elle impliquait des hommes et des femmes ou inégale parce que nombre de ses hypothèses inhérentes étaient fondées sur les désirs et les circonstances des hommes ?
Il n'y a jamais eu de réponse qui me semblait honnête et fidèle à mes sources et à moi-même. Je ne peux pas prétendre avoir trouvé une solution magique. Pourtant, je me suis rendu compte qu'une partie de ma difficulté résidait dans les hypothèses que je faisais sur l'écriture historique et qui, franchement, ne résistaient pas à l'examen. Tout d'abord, j'avais la conviction persistante que quelque part, si je réfléchissais suffisamment, il existerait une définition "objective" et "authentique" de ce qu'implique le féminisme. L'abandon de l'idée que je n'avais tout simplement pas assez travaillé sur la solution était un élément permettant d'échapper à l'impasse de la recherche du récit parfait. Dans le même ordre d'idées, et à la suite de cette reconnaissance, j'ai abandonné l'idée que chaque partie de mon livre devait avoir un arc narratif parfait, c'est-à-dire un début, un problème, une discussion pour résoudre le problème et une conclusion. L'érudition ne pourrait-elle pas être un peu plus post-moderne et se passer de démêler tous les fils et de fournir des réponses à toutes les questions ? Est-il si peu érudit d'admettre les divergences entre les preuves et l'incapacité de parvenir à une conclusion décisive ? J'écris ces lignes avec la ferme conviction qu'une pleine application de cette "culture de la défaite" reviendrait à abandonner le devoir de l'historien.
Mais peut-être, juste peut-être, l'histoire des subjectivités non compatibles de l'auteur et du protagoniste est-elle aussi, sinon plus, captivante et révélatrice qu'une conclusion lisse sans trace des défis qui ont dû être surmontés ? En d'autres termes, la route cahoteuse et non pavée révélant le paysage accidenté pourrait dans ce cas être préférable à l'autoroute pavée, où tout le contexte est éloigné et à peine reconnaissable. Ce que j'ai fini par écrire, c'est que mes sources et moi n'étions pas d'accord et pourquoi je pense que c'était le cas. J'ai reconnu la conception du féminisme de mes interlocuteurs (qu'ils n'auraient pas appelé féminisme) tout en soulignant ma version et les conclusions divergentes que ces différentes définitions ont produites. J'ai admis que, dans ma subjectivité, une grande partie de ce qu'elles avaient vécu était caractérisée par la discrimination sexuelle, mais j'ai dû admettre que leur version de l'autonomisation n'était pas seulement le fruit de leur imagination, mais aussi une stratégie que j'utilise moi-même lorsque je suis dans l'ancienne Union soviétique. Le pouvoir féminin peut prendre de nombreuses formes - et moi, avec mon étrange accent et ma situation personnelle quelque part entre la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Union soviétique, je le savais mieux que quiconque.
Alors comment faire de la subjectivité une amie ? Comment faire face à la vivacité persistante du moi auteur ? La première étape consiste certainement à reconnaître et à embrasser le moi historien. Sa présence est inéluctable pour nous comme pour nos sujets. Nous pourrions aussi bien en tirer le meilleur parti. Je propose de faire du soi de l'auteur le facteur amusant du processus historique - le joker qui peut toujours ajouter un autre angle surprenant. C'est aussi le facteur qui nous rend uniques, nous et notre travail. En d'autres termes, ce sont nos subjectivités d'auteur qui créent l'originalité convoitée du travail historique. Plutôt que de penser que nous ratons nos récits en étant subjectifs, embrasser notre subjectivité peut nous rappeler ce que nous ajoutons à l'histoire. Je crois fermement qu'il y a toujours une raison pour laquelle les historiens écrivent sur les sujets qu'ils abordent - parfois les raisons sont évidentes comme la parenté, l'identité partagée ou l'activisme politique, et parfois moins - comme un universitaire anglais d'Allemagne de l'Ouest écrivant sur les hippies soviétiques. Pourtant, notre propre motivation est la boîte à trésors cachée de la façon dont nous façonnons, individuellement et très personnellement, le débat historique. La deuxième étape doit consister à rendre transparent le processus de cette auto-reconnaissance. Plutôt que de nous cacher, nous devons fournir la "transparence radicale" qui rend la production de textes historiques intéressante en soi. Il est paradoxal que nous discutions de nos mécanismes de production dans des ateliers et des conférences, mais rarement par écrit et presque jamais dans le produit final. En effet, nous écrivons plus souvent sur la production historique des autres que sur la nôtre. Cela s'appelle l'historiographie. N'est-il pas temps d'inverser les rôles et d'accorder à nos propres auteurs la même attention, le même examen et les mêmes honneurs ?