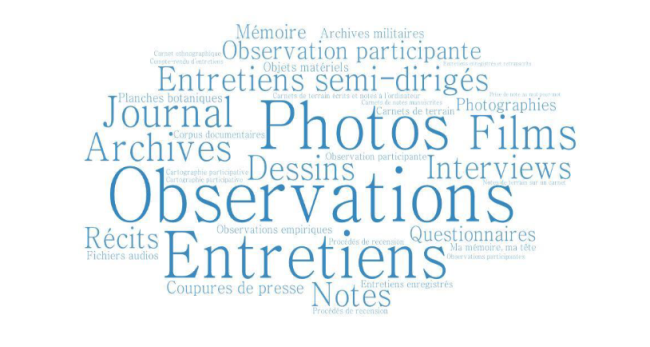Lorsqu'il écrivait sur les méthodes et les pratiques de l'interprétation culturelle il y a plus de trente ans, James Clifford (1986, 7) décrivait les vérités ethnographiques comme intrinsèquement "partielles", fondées sur des limites externes et auto-imposées, ainsi que sur des exclusions systématiques et des traductions contestables des réalités des autres. À travers les souvenirs de mes propres expériences de travail sur le terrain à Narva, une ville estonienne frontalière de la Russie, ce chapitre répond à la remarque sans âge de Clifford. Il déplace notre regard des nombreux outils méthodologiques utilisés pour fouiller le kaléidoscope de souvenirs et d'identités des personnes interrogées vers ceux du chercheur qui rend ces fouilles possibles.
Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, l'Estonie, le pays dans lequel je suis né et j'ai grandi, s'est profondément engagé dans un projet de renaissance nationale, reconfigurant les limites de son identité nationale et les contours de son appartenance nationale légitime. Depuis son indépendance, les élites politiques estoniennes ont tenté de consolider la position dominante des Estoniens de souche par rapport aux populations minoritaires très fragmentées et majoritairement russophones du pays (Agarin 2010). Elles y sont parvenues en imposant certains récits culturels et politiques tout en en omettant d'autres, ainsi qu'en mettant en œuvre une conception restrictive de l'appartenance politique par le biais de politiques officielles de citoyenneté et de lois linguistiques.1 Bien que les visions officielles de l'appartenance et de l'identité nationale aient connu plusieurs changements au cours des trente dernières années, les dérapages récurrents des politiciens et des acteurs non étatiques vers des récits ethno-nationalistes de la différence continuent de marginaliser de nombreux russophones. Ils servent de rappel douloureux de l'existence de "véritables porteurs de la culture estonienne" et d'autres "compatriotes issus de milieux culturels et linguistiques différents" (Kaljulaid 2021).
Après avoir été témoin et avoir expérimenté les effets dramatiques de tels dérapages discursifs sur la vie quotidienne des gens, j'ai commencé à m'intéresser à la compréhension des émotions, actions et réactions désordonnées parmi les populations minoritaires dont les opinions sont restées occultées par l'analyse des processus politiques. Cet intérêt s'est ensuite transformé en un projet de doctorat, dans lequel j'ai comparé les modes d'appartenance horizontaux parmi les individus russophones dans le contexte des zones frontalières post-soviétiques (Jašina-Schäfer 2021). En tant qu'universitaire russophone ayant étudié sa propre société en Estonie, j'ai souvent été encouragée à penser au local à travers la perspective de la distance, en mettant de côté ma propre histoire et toute idée préconçue personnelle qui pourrait discréditer une recherche objective sur ce contexte local. Les appels lancés au sein de ma discipline en faveur d'une méthode de recherche plus fiable et reproductible se sont toutefois heurtés à bien des égards à la prise de conscience croissante du fait que les conclusions de la recherche sont toujours soumises aux décisions subjectives et aux expériences antérieures du chercheur, ainsi qu'à notre inévitable socialisation dans des discours plus larges (Haraway 1988, Spivak 1985). Dans quelle mesure pourrais-je alors parler au nom d'autres russophones dont les vies sont si diverses, fragmentées et à bien des égards différentes de la mienne ? Comment encadrer ce travail dans une perspective critique, en donnant simultanément forme à différentes significations de l'appartenance et en remettant en question ces différentes articulations ? Au lieu d'un regard distancié, mon projet de recherche doctorale s'est défini autour de l'exécution de la réflexivité de mes propres positions complexes et enchevêtrées, des attentes qui y sont liées ainsi que des frontières changeantes des subjectivités.
La position du chercheur, sur laquelle je m'attarde dans ce chapitre, a été largement reconnue comme un aspect clé de la pratique de la recherche anthropologique. Pourtant, dans d'autres disciplines des sciences sociales et humaines, la réflexivité sur ses propres croyances, dispositions et pratiques reste pour la plupart " une profession de foi, un mot à la mode ou une injonction vide " (Alejandro 2019, 168). Nombreux sont ceux qui négligent encore d'examiner de manière critique les processus par lesquels les méthodes sont choisies et les revendications de recherche formulées. Dans ces cas, la réflexivité apparaît au mieux comme une pratique consistant à revendiquer une distance critique par rapport au terrain au nom de l'"objectivité" et de la "vérité", que les chercheurs espèrent atteindre en rendant le soi inconnu familier, conscient et explicite. Au pire, elle est présentée comme un nombrilisme égocentrique qui détourne l'attention des "véritables" résultats de la recherche.
Malgré ces critiques, nous ne pouvons tout simplement pas nous passer de la réflexivité. Surtout pas à une époque où parler au nom des autres depuis une position de pouvoir est de plus en plus contesté socialement (Dean 2017 ; Schröder 2020). Pour commencer à démêler la richesse, les contradictions et les complexités de l'étude des processus d'appartenance, nous avons donc besoin de moyens plus lucides pour évaluer les chercheurs qui tentent de donner un sens aux "réalités" désordonnées tout en étant eux-mêmes un faisceau de pensées et d'expériences complexes superposées au sein d'un assemblage social désordonné (DeLanda 2006 ; Deleuze 1995 ; Latour 2005). En d'autres termes, nous devons nous engager davantage dans une " réflexivité inconfortable " qui cherche à la fois à situer nos modes de connaissance et à les laisser simultanément ténus (Pillow 2003). En m'objectivant en tant que sujet d'analyse dans ce chapitre (Bourdieu 2003), je propose une manière possible de réaliser cette réflexivité inconfortable. Je combine les expériences dites macro des cadres disciplinaires avec le positionnement et les sens micro personnels. Je demande comment ces processus ont joué dans le flux de ma propre recherche ethnographique sur l'appartenance et les souvenirs de la population russophone dans l'Estonie post-soviétique ; comment ces processus ont façonné mes orientations épistémologiques et mes choix méthodologiques ; et comment ils ont affecté la dynamique de ma relation avec mes partenaires de terrain.
3.2 Réflexivité de la recherche : Sur le soi et le social
Citant Gilles Deleuze, John Rajchman (2000, 38) note que la seule façon d'entreprendre une recherche sans présupposés est de devenir une sorte d'"idiot russe" ou de penseur non éduqué, capable de "jeter sa "boussole herméneutique"" et de transformer son "idiotie" en un style de pensée différent4 . Il est certainement intriguant de penser à une vie académique sans les méthodes fixes, les formes préalables ou les hypothèses historiquement spécifiques que mènerait un idiot "libéré", comme un aveugle qui tâtonne et se déplace timidement sur le terrain. En effet, cela a été largement thématisé et même réclamé auparavant (Feyerabend 1993 ; Law 2004). Et pourtant, pour le chercheur qui, selon les mots de Pierre Bourdieu (1988, xi), est un "classificateur suprême parmi les classificateurs, dans le filet de ses propres classifications" et de ses modes de pensée opaques, un chemin pour devenir le penseur désappris est excessivement épineux, s'il est même possible.
Si nous acceptons de reconnaître cette complexité, par où commençons-nous avec la réflexivité ? Comment devrions-nous parler de nos positions et comment pouvons-nous pratiquer la réflexivité sans devenir trop égocentriques ? S'intéresser aux relations structurelles et historiques, que l'on appelle ici les perspectives "macro", pourrait être un moyen de surmonter l'accent mis sur la singularité et les essences pour lesquelles les approches réflexives ont souvent été critiquées. En effet, selon Pierre Bourdieu, il ne suffit souvent pas "d'expliciter les "expériences vécues" du sujet connaissant" ; les sciences sociales doivent également s'engager dans les conditions sociales qui ont produit le chercheur et le champ académique dans lequel il opère (2003, 282-83). En d'autres termes, toute recherche réflexive doit tenir compte de l'"inconscient épistémologique" (ancré dans les outils analytiques, les orientations théoriques et méthodologiques) et de l'"organisation sociale" du champ universitaire (par exemple, la position intellectuelle dans le domaine du pouvoir) auquel le chercheur lui-même appartient (Bourdieu et Wacquant 1992, 36 ; Kenway et McLeod 2004, 528).
En m'inspirant de Bourdieu, dans le travail réflexif ci-dessous, j'aborde ces macro-perspectives en exposant ma propre situation, souvent conflictuelle, entre un centre de recherche interdisciplinaire étudiant les cultures et le domaine international des études régionales, chacun étant dominé par des habitudes de pensée et des dispositions différentes, ainsi que par certaines attentes à l'égard des chercheurs en début de carrière. Étant intégrée dans ces différents domaines universitaires, je m'interroge sur la manière dont j'en suis venue à négocier les différentes frontières entre les approches théoriques et méthodologiques, ainsi que sur la manière dont j'ai ordonné et altéré les récits et les pratiques locales de mes interlocuteurs. En posant ces questions et en examinant les espaces dans lesquels j'ai lutté, je ne cherche pas à défaire ma propre recherche, mais plutôt à confronter et à contextualiser les représentations que j'ai employées.
Délimité par les disciplines, notre monde intellectuel reste néanmoins très incarné et personnalisé. Bien que Bourdieu minimise l'importance du positionnement personnel, notre situation sociale et nos positions dans la société sont préjudiciables à la façon dont nous apprenons sur cette même société (Harding 1987 ; Dean 2017 ; McNay 1999). De la même manière que les macrostructures peuvent imposer une censure intellectuelle, nos caractéristiques personnelles, nos expériences incarnées, nos relations de genre ou nos racines géographiques peuvent interférer et affecter nos pratiques de production de connaissances et nos résultats intellectuels, interférant avec les méthodes que nous utilisons (Pink 2012, 31-32). Dans la deuxième section empirique, que j'appelle les " micro " perspectives, je m'interroge sur la manière dont ma " perception sensorielle " du terrain (Pink 2015, 7), c'est-à-dire mes relations avec les personnes et les lieux que je rencontre, sont impliquées dans la recherche que je produis. En plaçant au centre de la discussion la notion d'ethnographe " natif ", cette section problématise les frontières étranglantes entre initiés et étrangers, en démontrant que nos positions sur le terrain sont un spectre situationnel et relatif plutôt qu'une simple dichotomie (voir également Miled 2017 ; Purwaningrum et Shtaltovna 2017).
À travers les exemples que je fournis ci-dessous, je reconstruis la réflexivité comme une pratique ouverte, qui combine des structures et des positionnements micro et macro au point qu'il devient impossible de démêler les deux entièrement. Il n'est pas non plus possible de déterminer laquelle des deux précède et définit nos choix de sujets, de questions de recherche, d'orientations méthodologiques et d'interprétations. Par conséquent, la réflexivité n'est pas utilisée ici comme un outil méthodologique pour transcender la subjectivité et devenir le penseur désappris tant désiré, visible par tous et donc impartial. Elle est plutôt utilisée pour réintroduire mes multiples moi complexes et mes mondes intellectuels en tant que couches supplémentaires constitutives de la manière dont nous mettons à nu les identités et les souvenirs complexes des personnes que nous analysons.
3.3 Orientations épistémologiques et méthodologiques : Ordonnancement et altération sur le terrain
Pourquoi ai-je choisi d'aborder et de représenter le sentiment d'appartenance des russophones de la manière dont je l'ai fait ? L'étude de l'appartenance est une préoccupation interdisciplinaire, et l'on s'accorde de plus en plus à dire que l'appartenance est faite d'intersections entre des attachements, des représentations et des émotions personnelles changeantes. Cependant, la façon dont les chercheurs appréhendent ce flux complexe reste souvent ancrée dans des trajectoires disciplinaires et des orientations théoriques et méthodologiques particulières. Étant liés par une interdisciplinarité qui cherche à désavouer les approches traditionnelles et à propager des modes de pensée plus larges, nous continuons souvent à retomber dans les filtres disciplinaires séparés, découpés par certaines perspectives et façons de faire dominantes (Abbott 2001 ; Bal 2002).
Au cours de mon affiliation au Centre international d'études supérieures pour l'étude de la culture à Giessen et de mon engagement dans un groupe de recherche appelé Global Studies and Politics of Space, je me suis particulièrement intéressée à l'utilisation de l'"espace" comme cadre pour découvrir des formes multidimensionnelles d'appartenance dans mes recherches. En considérant l'espace comme un " processus de rassemblement " pour l'évolution des paysages sociaux, politiques et culturels ainsi que pour les expériences quotidiennes individuelles (Pink 2015, 36), je me suis demandé comment les russophones vivent en relation avec un environnement ou un espace dans lequel ils se trouvent et, à leur tour, comment ils produisent eux-mêmes ces espaces. Quelles formes d'exclusion ou d'inclusion existent au sein de ces espaces et comment les frontières sont-elles maintenues par le pouvoir politique hégémonique ainsi que reproduites et dépassées par les russophones individuels ? L'idée que les espaces sont hétérogènes était certainement utile pour tenter d'éviter les représentations linéaires et tranchées des populations russophones dans l'espace post-soviétique. Mais elle a également suscité d'autres questions inévitables sur la manière dont je pouvais aborder cet espace fluide dans lequel vivent les individus.
Pour me faire une idée de l'évolution des processus, des relations et des significations, j'ai passé plusieurs mois à Narva, une ville frontière qui, comme le notent certains chercheurs, sert de "ligne de front épistémologique" entre les différentes échelles spatiales et temporelles du mondial, du national et du local, du soviétique et du post-soviétique (Kaiser et Nikiforova 2008, 545). Troisième ville d'Estonie, dont les russophones constituent environ 95 % de la population, Narva était autrefois une vitrine de l'internationalisme socialiste. Cependant, après l'effondrement de l'Union soviétique, elle a subi des changements radicaux qui l'ont plongée dans l'abandon et le désinvestissement. Grâce aux processus de nationalisation et de désoviétisation, les géographies culturelles familières de la ville ont disparu et ont été remplacées par de nouveaux symboles culturels et récits politiques. Elle a également fait l'objet de projets politiques corrosifs, qui ont laissé en ruine d'anciennes usines, sa maison de la culture (dom kul'tury), des parcs et des zones entières, au point que la ville est devenue, comme me l'a dit un journaliste local, "un non-lieu en voie de disparition" assigné à une position circonscrite en Estonie. Devenue apparemment invisible pour le projet national, Narva reste cependant un espace pertinent pour retravailler, défaire et renforcer certaines catégories politiques et visions du passé, du présent et du futur (Martinez 2020, 68).
Dans ce contexte particulier, je me suis procuré des informations sur la vie, les valeurs et les activités des russophones de Narva de différentes manières. Bien que la principale voie d'accès à ces informations ait été les entretiens narratifs approfondis avec des personnes d'âges, de sexes, de milieux professionnels et de positions sociales différents, les scènes de la vie ordinaire ont également été collectées par le biais de photographies contenant les lieux favoris passés ou présents des russophones dans la ville. En vivant aux côtés de mes interlocuteurs, j'ai rapidement remarqué que la plupart des histoires que j'ai recueillies étaient fondées sur des récits d'altérité interne, de non-implication, d'excentricité et de dislocation du courant politique, culturel et économique estonien. Tout comme la spatialité de la ville, les russophones eux-mêmes sont apparus dans ces récits comme des vestiges indésirables du passé soviétique que les politiciens de l'État souhaitaient éliminer plutôt que de rendre des comptes.
En même temps, un sentiment existentiel de dislocation est apparu parallèlement aux récits de mes interlocuteurs visant à combler les lacunes, les discontinuités et les déconstructions, par exemple en générant leurs propres sens du passé tel qu'il est invoqué dans la constitution actuelle de Narva. Dans certains cas (indépendamment de l'âge ou du statut socio-économique de la personne interrogée), Narva était imaginée comme historiquement estonienne, moderne et intrinsèquement " occidentale ". Dans d'autres, la ville était russe, la russité portant une signification hétérogène souvent détachée de l'État russe lui-même. Dans d'autres cas, Narva a émergé à travers des images différentes mais entremêlées de russité, d'estonianité et d'européanité. Le raccommodage s'est toutefois produit par une multiplicité d'autres moyens plus performatifs : des déclarations politiques collectives comme l'alliance politique Our Narva formée en 2017 pour contester les images négatives de la ville ; l'engagement dans des célébrations publiques pour le jour de l'indépendance estonienne ; des initiatives culturelles, à la fois spectaculaires (par exemple, concourir pour le titre de Capitale européenne de la culture 2024) et banales (par exemple, se porter volontaire pour nettoyer les rues ou organiser des événements sportifs pour la jeunesse locale). Toutes ces pratiques ont aidé les russophones à remettre en question les positions qui leur étaient attribuées par les récits officiels de l'État, en créant leurs propres idées de "normalité".
Je me suis convaincu que mon adhésion à la reconstruction de l'appartenance russophone d'une manière ouverte était le résultat de mon travail mené depuis le centre d'étude de la culture. Cependant, d'autres questions se sont posées : Dans quelle mesure d'autres positions antérieures ont-elles été intégrées dans le processus de recherche ? Et dans quelle mesure, tout en privilégiant vocalement le désordre, ai-je réduit ma recherche à ordonner, délimiter et couper les choses ? En feuilletant mes notes de terrain, je me souviens de plusieurs moments et récits de recherche que je jugeais moins importants pour mon cadre de recherche pour diverses raisons. Par exemple, je me souviens d'un jeune homme, Sergei, que j'ai rencontré sur les conseils de son frère aîné.5 Lors de notre première promenade le long de la rivière, Sergei m'a raconté son déménagement à Tallinn où il a passé quelques années à travailler dans un entrepôt d'un magasin d'alimentation, son retour, l'expérience d'être au chômage pendant les six derniers mois et d'avoir perdu la plupart de ses économies en faisant la fête avec ses amis. Déçu par ses espoirs inassouvis de créer une vie différente dans la capitale, Sergei est retourné à Narva, mais il s'efforce depuis de déterminer sa prochaine étape.
À toutes mes questions maladroites sur sa vie à Narva avant et après son déménagement, Sergei a toujours donné la réponse laconique que Narva est "si ennuyeuse" qu'il n'y a littéralement rien à discuter : "Toutes les mamies portent les mêmes chapeaux violets et tout le monde semble porter les mêmes vêtements". Le seul divertissement et, par extension, la seule vie que Sergei pouvait imaginer pour des jeunes comme lui était de "faire la fête avec de l'alcool" (pyanka gulyanka). On avait l'impression qu'il n'avait aucune opinion sur le pays dans lequel il vivait, et qu'il ne voulait pas non plus dire grand-chose sur le pays au-delà de la frontière. Au lieu de cela, toute sa conversation réservée était consacrée à ses rêves de richesse matérielle et de réussite, ainsi qu'à des souvenirs de fêtes et de vacances récentes. Au fil du temps, je me suis sentie poussée à poser de plus en plus de questions fermées et directes pour alimenter nos conversations. Je me suis également sentie quelque peu frustrée de ne pas savoir comment placer ces types d'histoires de vie personnalisées parmi les histoires des autres qui semblaient circuler différemment mais, selon moi, autour de récits similaires d'estonianité, d'européanité, de soviétisme et de russité.
Alors que l'histoire de Sergei peut être considérée comme une recherche existentielle d'une bonne vie (Vonderau 2010), qu'il cherche à matérialiser dans le contexte de la décadence de Narvan et de la diminution des opportunités pour les jeunes, je me suis retrouvé à privilégier clairement d'autres perspectives qui alimentaient, ou plus manifestement transgressaient, les catégories traditionnelles du "nous" et du "eux" qui ont acquis une large domination politique. Comment, alors, les débats politiques en cours sur la citoyenneté d'État, la langue russe et les écoles ont-ils joué dans mes propres convictions sur ce que devrait être l'appartenance dans le contexte de l'Estonie ? Comment les multiples discours sociopolitiques contradictoires que j'ai internalisés se sont-ils transformés en catégories "prêtes à porter" (Robertson 2002, 788) ? De plus, comment ces tactiques de hiérarchisation sélective se sont-elles ancrées dans mes travaux universitaires antérieurs ?
En tant qu'étudiante du nationalisme et de la construction de la nation dans un département d'études régionales, j'ai été, par exemple, particulièrement impressionnée par le cadre triadique de Roger Brubaker (1996). Tentant de recadrer la compréhension académique du nationalisme, Brubaker a proposé d'étudier l'interaction et la juxtaposition de trois éléments différents mais enchevêtrés : les minorités nationales avec leurs positions et leurs perceptions complexes, les positions des Etats nouvellement nationalisés dans lesquels les minorités vivent et les positions de la patrie nationale externe à laquelle elles sont censées appartenir. Selon Brubaker, les minorités nationales et leur sentiment d'appartenance sont toujours coincés entre les nationalismes mutuellement antagonistes des États nationalisants qui imposent des politiques promouvant les intérêts spécifiques de la nation centrale aux dépens des minorités et les patries nationales externes qui se dressent en opposition directe à ces politiques, revendiquant leurs responsabilités vis-à-vis de "leur" parent ethno-national à l'étranger. Cette approche a, à son tour, grandement influencé la manière dont les chercheurs interprètent aujourd'hui les politiques identitaires dans l'Europe centrale et orientale post-communiste. La plupart des recherches antérieures sur la population russophone dans l'espace post-soviétique ont utilisé le cadre de Brubaker ; je l'ai personnellement appliqué à la recherche sur la politique des compatriotes russes à l'étranger qui a constitué ma thèse de maîtrise (Jašina 2015). Bien que cette triade ait acquis une applicabilité presque habituelle, les jeunes chercheurs étant encouragés à se familiariser avec ce cadre, elle est parfois critiquée pour s'être concentrée exclusivement sur les récits qui découlent principalement des discours et des politiques de l'État, tout en négligeant les micro-pratiques des minorités elles-mêmes (voir par exemple Kudaibergenova 2020).
Dans mes recherches, j'ai donc dû lutter entre la prudence à l'égard des limites explicatives du cadre, notamment parce qu'il ne permet pas d'examiner en profondeur l'existence stratifiée des minorités, et la complicité dans l'adoption d'une perspective de " grand récit " et dans le regard porté sur le terrain. Ces grands récits ont commencé à structurer les multiplicités, le chaos et les mutations que représente la vie post-soviétique à Narva et que j'ai cherché à dépeindre par une approche spatiale de l'appartenance. Cet exercice d'équilibre complexe m'a accompagné tout au long du processus de recherche et jusqu'à la présentation de mon livre.
3.4 Le chercheur en tant que personne de l'intérieur, de l'extérieur ou entre les deux
C'est peut-être aussi ma voix qui, d'une certaine manière, a éclipsé la perspective de Sergei. Comme nos multiples expériences physiques et sensorielles représentent une voie claire par laquelle nous produisons des connaissances (Pink 2015), je me demande comment je me suis sentie en arrivant sur le terrain, comment mes interlocuteurs m'ont positionnée, ainsi que comment ces perceptions et ces positionnements ont façonné la façon dont j'ai compris la vie des russophones de Narvan. Bien que de tels moments de réflexion servent souvent à situer un chercheur dans un spectre binaire d'initié et d'étranger qui transmet une position apparemment claire et nette, je vise ici le contraire. En tant qu'être humain multisensoriel, non seulement je me suis présenté au cours de la recherche de multiples façons changeantes, en ayant des expériences divergentes et changeantes, mais j'ai également été reçu et étiqueté différemment par les personnes avec lesquelles j'ai interagi. Cette pluralité, ce changement continu et ce déplacement rendent toute position fixe impossible à maintenir et, par conséquent, problématisent à la fois l'autostéréotype et les descriptions descendantes de catégories telles que l'ethnographe "indigène" ou "local" (Bal 2002, 19).
En entrant sur le terrain et en menant des recherches avec des russophones en tant que russophone moi-même, je me suis souvent retrouvée positionnée au sein de pratiques conflictuelles d'homogénéisation et d'hétérogénéisation. Les russophones en Estonie sont souvent regroupés dans un cadre de politique identitaire basé sur une langue commune, des expériences passées et présentes, et leur position actuelle en tant que "société parallèle" en Estonie.6 Ce regroupement, qui est souvent effectué par les chercheurs eux-mêmes, me positionnerait inévitablement comme un initié, quelque peu relatable et critiquement intime au terrain. Pourtant, je ne peux pas revendiquer superficiellement ce statut d'initié ou cette connaissance, car de nombreuses différences existent entre moi et mes interlocuteurs, à commencer par les espaces géographiques dans lesquels nos vies se sont déroulées.
Avant mon travail de terrain, le seul sentiment que j'avais de Narva en tant que Tallinner était façonné par les stéréotypes des médias qui rapportaient des taux de criminalité, de chômage et de problèmes de drogue en hausse. Ces images plutôt négatives étaient encore diluées par mes propres souvenirs d'enfance, qui me rappelaient la grisaille accablante que j'observais par la fenêtre du bus lorsque je traversais la frontière russe avec mes parents. Au cours de mon travail de terrain, plusieurs aspects de la vie quotidienne dans la région frontalière m'ont frappé, certains avec lesquels j'ai appris à vivre au fil du temps, d'autres qui continuent à me rappeler la particularité de Narva. Par exemple, je me souviens encore clairement d'avoir été frappé par la présence écrasante du vide dans la ville, résultant à bien des égards des reconfigurations spatio-temporelles post-socialistes et des arrangements du pouvoir. En me promenant dans ce qui était autrefois l'un des quartiers les plus peuplés de la ville, Krenholm, je me suis retrouvée entourée de maisons et de rues vides, d'immeubles en ruine et de fenêtres défoncées, qui témoignent de la situation marginale de Narva et du manque d'intérêt national à son égard. Comme j'étais attiré par les images d'abandon, de désindustrialisation, de fermetures et d'exode conditionnées par la situation de la ville, je n'ai pu m'empêcher de me demander comment mes interlocuteurs donnaient un sens à cette nouvelle réalité et comment ils comprenaient la place de Narva par rapport à l'Estonie et au reste du monde. L'humeur mélancolique de leurs observations semblait liée au changement palpable du vide croissant, à l'irréversibilité du temps et à l'imprévisibilité de l'avenir (voir aussi Dzenovska 2020).
Lors de mon séjour à Narva, je me souviens également avoir eu un sentiment dissonant dans différents espaces publics, visuellement encadrés par la langue estonienne à travers des textes ou des panneaux, mais animés et dominés en pratique par le russe. En apportant de Tallinn une habitude personnelle d'ordonner les espaces et selon les langues parlées, j'ai essayé de communiquer automatiquement en langue estonienne dans les lieux publics comme les magasins ou les cafés. Cependant, cela entraînait parfois une certaine confusion, tant pour la population locale que pour moi-même, perdue non seulement dans la traduction vers ma langue maternelle mais aussi dans des réflexions plus générales sur le degré de " russité " de mon russe. En effet, dès que j'ai commencé à prêter plus d'attention aux différences spatiales, les récits conventionnels de la culture russophone ou l'image commune de la vie en Estonie ont commencé à s'effondrer, se transformant en quelque chose que je sais et ne peux pas savoir.
Tout comme j'essayais de donner un sens à ce quotidien, quelque peu familier et pourtant si profondément défini par la situation frontalière et ses contradictions incommensurables, mes interlocuteurs créaient également des positions propres pour eux-mêmes et à mon égard. Pour certains de mes interlocuteurs, par exemple, mes propres origines de Tallinn sont devenues un point de référence particulièrement important autour duquel une grande partie de la conversation a tourné. Lorsque j'ai rencontré Natalya, une femme d'une cinquantaine d'années, elle s'est emballée à la mention de Tallinn. Après avoir passé plus de trente ans dans la capitale, Natalya a vendu son appartement au début des années 2000, rompu ses relations antérieures, déménagé à Narva et s'est "retrouvée coincée ici". Dans les conversations entre deux Tallinnois, comme l'a dit Natalya elle-même, le lieu en tant que tel a joué un rôle essentiel dans la réflexion sur ses expériences quotidiennes, ses recherches d'emploi et l'évolution de sa relation avec les gens et la ville. En déménageant d'Estonie en Estonie et non, comme elle me l'a dit, dans un village russe sans nom, elle espérait trouver un nouvel emploi dans une entreprise de couture et était certaine de pouvoir y arriver. La rareté des emplois dans la ville, cependant, était une grande source de tension, et elle se souvenait souvent de son séjour à Tallinn et jugeait quelque peu la façon dont les affaires se font à Narva : "Ici [à Narva], il y a une mentalité particulière de jalousie. Les gens n'apprécient pas le travail, le temps et les efforts que vous investissez. Mais tout le monde aime compter votre salaire au point de vous enlever un emploi. Je me suis battu, j'ai essayé de prouver quelque chose, je suis passé d'une entreprise à l'autre, je suis passé par toutes les entreprises de Narva. C'est la même chose partout". L'idée que Narva a une mentalité particulière profondément enracinée dans l'ère soviétique et dans sa décadence actuelle a convaincu Natalya de sa non-appartenance à la ville et de sa propre non-russité (ya ponyala, chto ya ne russkaya), avec une forte aspiration à la culture estonienne et à ses modes de vie respectueux de la loi.
Un autre habitant, Vello, âgé de quatre-vingts ans, m'a qualifié, à ma grande surprise, d'Estonien (eestlane) - le mot réservé à la population ethniquement majoritaire. Vello était un représentant des très rares Estoniens de souche de la ville et, peu après m'avoir entendu parler estonien dans le vestiaire d'une bibliothèque (une de ces vieilles habitudes), il a engagé la conversation en exprimant le désir d'en savoir plus sur moi. Ayant entendu d'autres interlocuteurs dire combien il est souvent difficile d'entrer en contact avec la communauté estonienne locale, réservée dans ses propres réseaux et espaces de rencontre, j'ai trouvé cette situation fortuite. Plus je parlais avec Vello, qui trouvait qu'il y avait trop peu d'Estoniens et que l'on parlait trop peu l'estonien à Narva, plus je reconnaissais que la compréhension de l'estonianité change dans l'espace, non seulement pour la population russophone locale, mais aussi pour les Estoniens de souche qui utilisent différentes échelles pour tracer et négocier les frontières de la communauté. Dans ce cas, ma langue estonienne, bien qu'accentuée, a semblé suffisante à Vello pour m'accueillir dans le "club", où nous pouvions parler ensemble des autres russophones locaux depuis une position d'outsider.
Ma situation géographique et ma langue n'étaient certainement pas les seuls aspects autour et contre lesquels mes interlocuteurs et moi-même avons façonné leurs positions. D'autres moments de gêne, d'insécurité et de confort se sont également glissés dans mes perceptions sensorielles du terrain, au point de déstabiliser toute distinction facile entre distance et proximité, détachement et connexion, et par extension ma propre intériorité, extériorité et entre-deux en tant que chercheur. En outre, ils ont compliqué toute compréhension directe de l'estonianité ou de la russité, locale, nationale ou mondiale, en tant qu'états imaginaires de l'être que les russophones pratiquent dans leur vie quotidienne.
3.5 En lieu et place d'une conclusion
Dans un monde où la nécessité politique de donner un sens aux dynamiques sociales, politiques et culturelles qui nous entourent est évidente, il est tout aussi nécessaire de confronter et de contextualiser les représentations que nous employons en tant que chercheurs. Une recherche plus autoréflexive est toujours nécessaire au lieu de chercher la bonne méthode pour débloquer ou catégoriser la vie des gens, reproduisant parfois sans le savoir les structures hégémoniques contre lesquelles nous souhaitons travailler. Le travail de réflexivité effectué dans ce chapitre offre un moyen de démêler la richesse et les contradictions des éléments intersubjectifs qui ont joué dans le processus de recherche et défini mes orientations ethnographiques. Mais comme il n'offre peut-être pas ce que nous pourrions tous appeler une "méthode scientifique standard", il soulève plutôt plus de questions que de réponses. À travers les exemples désordonnés de pratiques académiques et les vignettes ethnographiques de positionnements flous, ma modeste intention n'est donc pas de fermer d'autres manières de faire de la réflexivité. Ces exemples servent plutôt de plaidoyer pour encourager la recherche interdisciplinaire, confinée dans des visions disciplinaires, à devenir plus responsable lorsque les luttes des gens pour l'auto-identification, la reconnaissance et l'appartenance sont en jeu.